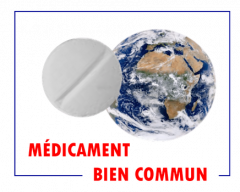Maurice Cassier est sociologue, directeur de recherche au CNRS. Passé par l’Ecole des mines, sa thèse de sociologie, a porté sur les relations entre les laboratoires publics et l’industrie.
Son champ de recherche l’a conduit à mener des études sur les brevets sur les gènes (fin des années 80, début 90), notamment sur les oppositions aux brevets sur les gènes du cancer du sein, jusqu’à leur invalidation en Europe et aux États-Unis, à développer un programme de recherche sur les génériques et à s’intéresser à l’histoire des brevets sur les médicaments, depuis leur autorisation en France, dès la fin du 18e siècle. Il étudie les partenariats public/privé des laboratoires pharmaceutiques au Brésil et suit les travaux de MSF et ses relations avec DNDI, notamment en ce qui concerne le développement des antipaludéens.
Cet entretien a été réalisé lors d’une rencontre avec le collectif Médicament Bien Commun le 14 janvier 2021.
Médicament bien commun : Comme vous avez pu le lire dans notre Manifeste “Pour une appropriation sociale du médicament”, notre groupe se mobilise autour de 2 thèmes majeurs : médicament bien commun et propriété intellectuelle. Nous pensons que ces 2 thèmes sont étroitement liés, et nous aimerions en discuter avec vous.
Médicament bien commun : Pensez-vous que la remise en question du droit de Propriété Intellectuelle appliqué aux brevets sur les médicaments soit un bon angle d’attaque pour remettre en question la position monopolistique ou oligopolistique des Big Pharma ? De nombreuses études ont montré que le monopole de l’innovation dans l’industrie pharmaceutique n’était pas une méthode efficace pour augmenter l’innovation (promesses non tenues des brevets).
Maurice Cassier : La propriété intellectuelle (PI) est un angle d’attaque important et stratégique.
Le brevet est une institution ancienne. Très tôt, les juristes et législateurs ont posé la question des impacts des brevets sur les médicaments : constituent-ils des barrières, comment impactent-ils la santé publique ? De nombreux changements, définis essentiellement par les pouvoirs, ont eu lieu depuis leur naissance. Au 19e siècle, les brevets étaient utilisés pour la publicité, pour faciliter la vente de produits potentiellement douteux. Jusque dans les années 50, les pays accordaient des brevets surtout sur les procédés et non sur les molécules, comme en Allemagne. Les États-Unis étaient un des rares pays à accorder des brevets sur les produits pharmaceutiques. Les brevets sur les procédés étaient considérés comme stimulant l’innovation et encourageant les industries à innover. La France, au début du 20e siècle, n’accordait pas de brevets sur la production pharmaceutique. Il y avait une foule de laboratoires très dispersés. Il n’y a pas eu de brevets sur les molécules jusqu’aux années 60.
Dès que l’on a mis des brevets sur les molécules, le pouvoir de monopole est devenu plus fort, pour contrôler le marché, imposer les prix et générer des rentes très importantes. Ceci n’est pas la seule raison de la création des multinationales mais constitue un principe d’accumulation déterminant et un enjeu de pérennité des Industries Pharmaceutiques (IP). Le brevet est aussi largement utilisé par les petites sociétés (start-up) pour accumuler des ressources financières. Le brevet est donc une institution d’une très grande plasticité.
Depuis les années 80, la brevetabilité du médicament a favorisé la concentration économique, la rente de monopole, et le pouvoir des brevets a acquis une autre dimension : avec la financiarisation de l’IP, il est devenu fondamental pour contrôler le marché et l’accumulation du capital, notamment au travers des échanges des firmes, entraînant des phénomènes spéculatifs, impactant la réorganisation de la recherche, avec depuis les années 2000, une répercussion sur les courbes des prix. Aujourd’hui il est devenu un actif financier en tant que tel.
Ainsi les brevets, comme tout type de droits, structurent l’organisation économique. Ils organisent l’accumulation du capital, d’où un impact extrêmement important. La PI est un débat structurant l’économie, non pas à côté de l’économie (exemple actuel des vaccins), d’où le large spectre des questions qu’elle pose.
Comment peut-on faire évoluer le système ? Si on fait bouger les brevets, on fait bouger la dynamique de l’accumulation capitaliste. Donc si on touche les brevets, il faut être attentif à tout le dispositif industriel que l’on va toucher. Redéfinir le cadre des brevets revient à redéfinir le cadre des financements.
Comment en sortir ? Ce système est très organisé autour des produits, mais il n’est pas d’un bloc. Il faut aussi s’intéresser aux contours, être attentif aux extensions. Depuis les années 2000, des critiques, des réflexions sur les nouvelles conditions d’admission, des expériences ont vu le jour. Il faut faire l’historique de ces expériences et s’appuyer sur elles pour imaginer les solutions de sortie, ne pas faire table rase de ces réflexions.
MBC : Dernièrement, en Europe, est intervenue une modification du statut des brevets des médicaments : quelles conséquences, quel regard avoir sur ces nouveautés ?
MC : Un brevet européen unique a toujours été un objectif. Les brevets ont d’abord été nationaux. Les brevets dits d’importation, qui autorisaient en France la prise d’un brevet sur une technologie étrangère, autrement dit de s’approprier licitement les inventions des autres pays, ont été supprimés dans les années 1840 en France. Dans les années 1970, on a mis en place une convention européenne sur le brevet et un office européen des brevets, mais toujours décliné par pays. En cas de litige, ce sont les juristes et tribunaux du pays qui arbitrent. Plus récemment on a introduit un brevet européen unitaire pour réduire les coûts de dépôts et de défense des brevets.
Le niveau européen de la régulation facilite le travail des entreprises et des conseils en brevet, par une homogénéisation de la procédure, mais ne modifie pas les limitations des effets délétères des brevets. Il n’y a pas de brevet mondial, même s’il y a des traités internationaux (OMC) pour harmoniser les standards communs avec des variations nationales.
MBC : La Sécurité Sociale (SS) est une spécificité française. Les firmes pharmaceutiques, dont Sanofi, doivent leur fortune à la Sécurité Sociale : argument de poids pour exiger que les Big pharma se plient à la réglementation renforcée des génériques. Qu’en pensez-vous ?
MC : C’est un sujet important. A la naissance de la SS, en 1945, il n’y avait pas de brevets de médicaments en France. La SS se préoccupait beaucoup à sa naissance de la régulation du prix des médicaments. A la fin des années 50, quand on parle d’autoriser les brevets sur les médicaments, il y a des discussions dans les organismes de la SS, plutôt hostiles aux brevets, par crainte de renchérissement des prix.
La SS est un terrain essentiel pour interroger le poids des brevets sur les prix et exiger de la transparence car elle est par excellence un bien commun (BC) – ce pourquoi elle est objet d’attaques. Compte tenu de sa puissance budgétaire, elle devrait être un acteur majeur de la régulation de l’économie de la santé, de l’accès aux médicaments. La couverture santé assure la solvabilité du marché (payeur social). La SS devrait avoir des pouvoirs de suspension des brevets, de demandes d’utilisation de licences d’office (LO), de pression sur les prix. Elle devrait même disposer de ses propres laboratoires de production de génériques.
La SS est sans doute l’acteur le plus important de cette régulation. C’est un commun qui a été étatisé, il faut le désétatiser. Il faut repolitiser la SS. En 1945, la SS était très faible financièrement, mais elle était très politique. C’est un des terrains de luttes à ouvrir.
MBC : Pouvez-vous nous parler d’expériences dans d’autres pays, de leur succès et de leurs limites ?
MC : On peut faire des expérimentations très audacieuses mais avec patience et prudence. On ne peut pas revendiquer la suppression des brevets du jour au lendemain… Par exemple : dans le cadre de l’épidémie de Covid-19, un économiste américain, qui a travaillé sur la crise financière, proposait de mettre en open source tous les résultats de recherche ; l’open source permet l’accessibilité à tous de certaines innovations. Ce serait une expérience. Mais elle n’a pas suscité d’adhésion des autorités. Par contre elle est dans le débat public.
En ce moment, pour les vaccins, une pénurie se profile, car les technologies ne sont pas mutualisées. Avec la mutualisation, sans brevets ou avec mutualisation des brevets, on pourrait régler le problème. La production pourrait être étendue aux pays du Sud. Par exemple : le Brésil va fabriquer le vaccin AstraZeneca grâce à un accord de transfert de technologie.
Pour développer l’innovation, il faut développer des champs d’expériences sans brevets. Ainsi DNDI a permis le développement de plusieurs médicaments soit sans brevet, soit sous contrôle (Licence open source donnant un droit de surveillance ; car le domaine public peut aussi mener à des dérives : aussi les licences open source permettent non seulement de partager la technologie mais aussi d’en organiser la défense).
Quelles sont les revendications possibles ? Le brevet est une institution vieille de 4 ou 5 siècles. On peut l’attaquer résolument, mais de manière très précise, de plusieurs côtés à la fois.
MBC : La remise en cause des brevets nous amène à réfléchir sur de nouveaux modèles à mettre en place, notamment en recherche. Comment voir les interactions entre recherche privée et recherche publique ? Que penser des partenariats public-privé ? Actuellement la recherche est surtout orientée en fonction de la rentabilité des résultats. Quelles alternatives possibles ?
MC : La recherche est effectivement un champ d’action important. La recherche publique et la recherche universitaire sont des leviers importants. Il n’y pas d’IP sans interaction avec les universités. Les premières entreprises dérivent des universitaires. Elles utilisent les résultats de la recherche publique.
Les universitaires sont souvent très réticents à prendre des brevets. Les organismes de recherche doivent trouver comment définir de nouveaux modèles. Des débats ont lieu à l’INSERM ou au CNRS sur la prise de licences non exclusives.
Des étudiants de l’UAEM* (Universités alliées pour les médicaments essentiels) réfléchissent à des modèles de licences non exclusives à la place de brevets. Il faudrait les revendiquer en France.
La France a une certaine force de frappe médicale. Elle pourrait créer des “pools” d’inventions des institutions publiques, en open source. Cependant, par ailleurs, au CNRS, certaines licences ont rapporté des royalties. Les organismes de recherche doivent donc « revoir leur copie » en ce qui concerne les brevets.
MBC : D’autre part, des chercheurs se battent pour la mise en commun des connaissances, prenant en exemple les bases de données publiques du génome.
MC : Effectivement, il y a un gros débat sur les génomes. Pendant longtemps les IP étaient contentes de profiter de ces bases de données mises à disposition, leur évitant l’investissement. Cependant ces bases de données du domaine public ne protègent pas assez, un opportuniste peut reprendre un résultat, l’amalgamer aux siens et déposer des brevets.
Le modèle de l’open source est préférable. Interdisant l’exclusif, c’est une forme de droit de propriété intellectuelle qui permet de laisser le système ouvert : les connaissances sont publiées mais avec droit de surveillance (exemple des logiciels libres).
MBC : La France est très en retard sur le séquençage génomique du SARS-CoV-2, et partage peu. Pensez-vous que cette base de données publique puisse être une façon de court-circuiter les startup ?
MC : La France a été un acteur important (à côté de la Chine, de la Grande Bretagne) pour le séquençage du génome humain. D’ailleurs la séquence du SARS-CoV-2, divulguée à l’échelle mondiale, a été faite par un consortium né en 2006 (GISAID) pour partager les connaissances (établi au départ pour la grippe). Cette base de données avait pour règle la diffusion des séquences, avec interdiction de prendre des brevets dessus.
Les start-up ne sont pas court-circuitées mais leur travail a changé : au lieu de capter la séquence d’un laboratoire public, elles développent de nouvelles technologies ou de nouveaux procédés. Par exemple pour la Covid-19, les premières recherches sur les tests ont été développées quelques jours après la publication du séquençage. D’ailleurs, l’Institut Pasteur a pu immédiatement développer un test de diagnostic. Idem pour les chercheurs de la Charité en Allemagne, à la différence que leur technologie a été industrialisée en Allemagne !
MBC : Pensez-vous que le médicament puisse devenir un bien commun (BC) ? Cela impliquerait au départ la mise en commun des connaissances et des savoirs et à l’arrivée une régulation de la production et de la distribution pour que le médicament soit accessible à tous. A l’opposé, le brevet le réserve à quelques-uns dans un but lucratif. Et dans ce cas quelles sont pour vous les arguments à développer et les luttes les plus importantes à mener ?
MC : Nous pouvons réfléchir de la même manière que pour le brevet. Il y a deux approches possibles :
- La première : le médicament bien commun (au singulier) ou public comme objectif politique (voir Dardot et Laval par exemple Commun).
- La seconde : le médicament, bien partagé, appuyé sur une technologie partagée, non exclusive. Ce dispositif se décline en termes d’approche économique, avec une gouvernance et les instruments juridiques qui vont permettre de lui donner forme (voir Elinor Oström, Gouvernance des biens communs). Il faut donc concevoir une série d’appareillages politiques, juridiques, institutionnels, des dispositifs de financement, une instance de gouvernement de ces biens.
Un vaccin, pour être un bien commun, nécessite des dispositions de partage de la technologie, des systèmes de financements (à l’exemple de DNDI). C’est une approche économico-politique. Il existe aujourd’hui des dispositifs dans ce sens, des outils de mutualisation… à inventorier.
MBC : Comment voyez vous l’industrie pharmaceutique au regard de cet objectif, une industrie aujourd’hui dictée par la finance, de la start-up au grand labo ? Comment concevoir une industrie qui soit développée dans le sens de l’intérêt général ?
MC : On peut énoncer des objectifs de BC, à l’encontre de biens privés mondiaux développés par les multinationales. Il s’agit de reprendre la main quand il y a utilisation de la recherche publique pour création de médicaments.
Les outils à actionner ?
- La Sécurité Sociale, pour la régulation des prix, y compris pour les produits des multinationales. Un rapport de sénateurs américains; en 2015 sur Gilead, explique par le menu la formation des prix des médicaments. Il faut politiser le prix des médicaments.
- La Propriété intellectuelle, par un dispositif de licences obligatoires – ou licences d’office (LO) – outil par lequel la puissance publique reprend le pouvoir à ceux qui font breveter (exemple du Brésil). Produire des médicaments en mobilisant au-delà de l’intervention de l’État, associations de malades, chercheurs…. pour que ce soit un BC.
- Le Canada, dans les années 70, a imposé des LO automatiques (400 en quelques mois). Les prix des médicaments y sont plus bas qu’aux USA. C’est le pouvoir des payeurs.
MBC : Y a-t-il eu d’autres LO mises en œuvre en France, à part pour le vaccin DT polio ? Les pays ont eu du mal à mettre en place les LO, en raison des menaces des producteurs.
MC : En France, depuis la LO instaurée en 1953, après mise en place des brevets sur procédés pharmaceutiques, il n’y a eu qu’un seul décret, en 1956, sur les vitamines. Les États ont toujours refusé les LO (elle a cependant été discutée en 2015 par le Ministère de la santé en France pour le Sofosbuvir) pour ne pas faire peur à l’industrie. Aux États Unis, la LO a fait l’objet d’études très complètes. La LO sur le médicament y est beaucoup utilisée dans l’armement et pour le médicament dans les années 1960 et 1970 : aucun impact négatif sur la recherche n’a pu être démontré.
Le médicament est un sujet très politique : au Brésil, le président Lula a d’abord craint de ne pas pouvoir vendre des oranges, s’il appliquait la LO. A partir de 2005, le rapport social a modifié la donne. L’Inde, jusqu’en 2005, a eu l’avantage d’avoir seulement des brevets de procédés et a pris une LO en 2012 sur un anticancéreux ; d’autres pays du Sud ont utilisé la LO (une centaine de LO ont été appliquées entre 2001 et 2016 selon une étude publiée dans le Bulletin de l’OMS).
MBC : Comment se fait l’articulation entre industrie publique et industrie privée ?
MC : Dans l’idée d’un pôle public, il faut prévoir certains arrangements.
Au Brésil, par exemple, les laboratoires publics ne font que de la formulation de médicaments, aucun ne fait de synthèse : il y a complémentarité entre le public et le privé, les labos publics achètent aux labos privés les principes actifs, puis le ministère de la santé achètent les médicaments aux labos publics.
Il y a place pour plusieurs types de montage : l’Association française contre les myopathies réfléchit à un laboratoire associatif ; des chercheurs réfléchissent à d’autres modèles pharmaceutiques – voir les travaux d’Alain Fischer sur le prix des médicaments ; de petits laboratoires de l’AP-HP fabriquent des médicaments sur mesure, pour traiter les maladies rares ; il existe une production hospitalière non négligeable, et pas seulement à l’AP-HP – par exemple à Lyon ; en Suisse, il existe des laboratoires publics hospitaliers pour développer les technologies CART-cells, ce qui est intéressant car ils travaillent en liaison avec les cliniciens.
MBC : Beaucoup d’alternatives émergent, témoignant de l’appropriation de la production par d’autres acteurs que les industriels. Comment leur donner plus de puissance ?
MC : Il faut considérer le niveau de politisation de la question de l’industrie pharmaceutique. Voir par exemple le rôle de l’IP dans les élections américaines, ou l’investissement public dans la recherche et l’achat de vaccins contre la Covid-19.
Il faut ouvrir le champ des alternatives, en commençant par l’inventaire des expérimentations et réalisations hors marché.