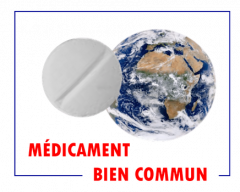Christian Laval, agrégé de sciences sociales, est professeur de sociologie à l’Université Paris Nanterre. Ancien membre du conseil scientifique d’ATTAC, il est co-directeur de la collection « L’horizon des possibles » aux éditions La Découverte et membre de l’institut de recherches de la Fédération Syndicale unitaire (FSU). Spécialiste de la généalogie de la représentation utilitariste puis néolibérale, il est l’auteur de nombreux ouvrages, dont en 2009 : la nouvelle raison du monde, Essai sur la société néolibérale. L’ouvrage, que Christian Laval et Pierre Dardot ont publié en 2015 : Commun, Essai sur la révolution au XXIe siècle, a retenu toute notre attention.
Entretien réalisé par le Collectif Médicament Bien commun (MBC) Manifeste pour une appropriation sociale du médicament
Comme vous avez pu le lire dans notre Manifeste “Pour une appropriation sociale du médicament”, notre groupe se mobilise autour de 2 thèmes majeurs : médicament bien commun et propriété intellectuelle. Nous pensons que ces 2 thèmes sont étroitement liés et nous aimerions en discuter avec vous.
- A propos de la notion de « Bien commun »
Médicament Bien Commun : Peut-on revenir sur la notion de « bien commun ». La pandémie mondiale actuelle semble accélérer la prise de conscience que la santé est un bien commun public mondial. Mais face aux pouvoirs monopolistiques des Big Pharma, cette conscience est plus hésitante à intégrer le médicament comme bien commun. Les signataires du Manifeste pour une appropriation sociale du médicament postulent que le médicament doit être un bien commun, comme principe d’une santé publique et environnementale à l’échelle planétaire. Ce manifeste revendique la suppression de la notion de propriété privée donc du monopole des droits de PI sur les médicaments attribués par les brevets d’invention. Il ne s’agit donc pas seulement d’affirmer la valeur universelle d’un droit d’accès à la santé.
Que pensez-vous de cette démarche ?
Nous souhaitons confronter cette visée avec le fond du concept. D’autant qu’avec les tensions sur la production et la mise à disposition mondiale des vaccins, il y a de la part des gouvernants, une volonté de détourner la notion de « bien commun », en parlant du vaccin comme Bien Public mondial (BPM). Peut-on clarifier la différence entre ces deux notions ?
Christian Laval : je souscris entièrement au Manifeste que vous avez publié, j’en suis d’ailleurs signataire, et je n’ai rien à y retrancher ni à y ajouter. Cette démarche est parfaitement dans l’esprit du travail que nous menons avec Pierre Dardot pour préciser ce que pourrait être une « politique du commun » dans tous les secteurs de la vie collective, et notamment dans le domaine de la santé. Nous n’en sommes pas des spécialistes mais nous comptons beaucoup sur tous ceux qui, dans chaque champ, s’y connaissent mieux, soit parce qu’ils y travaillent soit parce qu’ils l’étudient, pour prolonger et affiner nos propres réflexions qui gardent un caractère de généralité. Votre Manifeste trouve évidement aujourd’hui un large écho et ce n’est pas seulement à cause de la pandémie, même si elle joue un rôle de déclencheur.
Il y a de plus en plus de gens qui se rendent compte que la concurrence entre firmes, entre États, entre régions du monde, est catastrophique lorsqu’il s’agit d’un problème qui touche toute l’humanité. La question est aujourd’hui celle de savoir comment construire une politique du monde, pas seulement une politique mondiale, mais une politique qui fasse du monde l’espace pertinent et surtout qui fasse du monde une institution politique. Je m’explique : le monde n’a pas d’existence institutionnelle, sinon en pointillé, avec des organisations non pas mondiales mais internationales, par définition beaucoup trop travaillées et souvent paralysées par les intérêts nationaux. Une politique du monde, une cosmopolitique, doit avoir pour objectif l’institution politique du monde. Comme il y a une institution de la commune ou de la nation, il faut viser une institution démocratique du monde. Pourquoi et comment ? Précisément parce que nous courons à la catastrophe si la réponse aux défis posés au monde par la crise climatique, les pandémies, l’anarchie financière, les flux migratoires, et bien d’autres sujets sont l’objet de la concurrence entre entreprises et entre États.
C’est là, me semble-t-il, que se révèle dans toute son ampleur l’importance de poser un certain nombre de biens comme des biens communs. Non pas des « biens publics mondiaux » mais des biens communs. Quelle différence ? C’est assez simple, les BPM renvoient à la catégorie de « biens publics » de l’économie mainstream qui établit une distinction entre types de biens en fonction de critères techniques (non exclusivité, non rivalité). Les « biens communs » tels que nous devons les redéfinir dans une politique du commun renvoient à des exigences éthiques et politiques d’universalité et de solidarité, qui ne sont pas limitées par les catégorisations économiques qui font des biens marchands la règle et les autres des exceptions ! Le déplacement d’accent est radical, c’est même une opposition entre deux conceptions qui n’ont rien à voir l’une avec l’autre. D’un côté, le bien public est strictement défini par le discours économique dominant, et bien sûr derrière, par le fonctionnement du capitalisme qui a besoin que l’État produise des biens publics (éclairage des rues, phares, armée etc. pour reprendre des exemples classiques). Les économistes de l’ONU se sont un jour aperçu que l’économie mondiale avait besoin de biens publics pour fonctionner et que les États devaient coopérer pour produire les conditions minimales de son fonctionnement, voire contrôler ou neutraliser les effets désastreux qu’elle a entraînés.
Mais la confusion s’est établie entre la notion de « bien public » et celle de « bien commun ». Parler du vaccin comme un « bien public » c’est jouer sur les concepts. Le vaccin est un bien rival et même exclusif (si je le consomme, j’en prive les autres, et je peux parfaitement exclure beaucoup de monde …). Il a toutes les caractéristiques d’un bien marchand que les entreprises privées ont la légitimité de produire et de vendre pour faire le maximum de profits, dans le cadre de la pensée économique dominante s’entend. Il faut en sortir pour penser le médicament ou le vaccin comme un « bien commun », qui ne l’est que par la primauté donnée aux besoins impérieux et aux valeurs fondamentales qu’une politique entend faire respecter. Avec le « bien commun », on n’est plus du tout dans l’univers économique du capitalisme, on est dans un autre monde de valeurs.
- Enjeux de propriété et de pouvoirs
MBC : En ce sens, postuler que le médicament devienne un « bien commun », rejoint la définition du « commun » que nous avons comprise de l’essai que vous avez écrit avec Pierre Dardot[1]. Le commun est un principe et une construction politique, qui ne contournent pas les enjeux de propriété et de pouvoirs… « Dire que le commun, comme son étymologie l’indique, est d’emblée politique signifie qu’il oblige à concevoir une nouvelle institution des pouvoirs dans la société…Il donne à entendre qu’il n’est de monde humain souhaitable que celui qui est fondé explicitement et consciemment sur l’agir commun, source des droits et des obligations… ».
Dans l’engagement du Manifeste, nous ne réduisons pas ce principe au seul médicament. Nous plaçons les transformations nécessaires dans l’appropriation par la société de toute la chaîne du médicament, de la recherche à la production, à la distribution, sa prise en charge par la Sécurité sociale (donc la désétatisation de la SS), impliquant le dépassement de l’entreprise néolibérale et la transformation du travail.
Or cette question de propriété et de pouvoirs (non réduit au pouvoir d’État) est souvent contournée. Comment faire progresser cette appropriation ? Par quels leviers ?
CL : Ce sera peut-être pour vous une réponse paradoxale, mais ce que vous appelez dans le titre du Manifeste « appropriation sociale » ne peut être fondée que sur un principe …d’inappropriabilité. Approprier, appropriation ont plusieurs sens. Si vous voulez dire que la production de médicaments et la chaîne des soins doivent être appropriées aux besoins et aux valeurs d’une société, nous nous plaçons hors du champ de la propriété privée pour ce qui concerne des biens jugés essentiels pour la santé, le bien-être, mais aussi la liberté et l’égalité. Mais nous sommes aussi hors du champ de la propriété publique, si l’on entend par là la propriété d’État. Si un État a la propriété officielle ou officieuse d’un médicament ou d’un vaccin, il peut en faire une arme de contrôle, de pouvoir, d’influence sur son peuple comme sur les autres pays. La question est donc bien de savoir comment une production de médicaments peut faire l’objet d’une « appropriation » aux besoins de la société et du monde. Il ne le peut que si ce n’est pas la logique propriétaire qui l’emporte – laquelle donne le pouvoir à celui qui a le « titre de propriété », qu’il s’agisse d’une entreprise ou d’un État- mais plutôt celle de la démocratie. C’est en ce sens-là que le terme d’appropriation sociale me semble pertinent : seuls ceux qui sont les destinataires des soins et des médicaments sont en droit de décider de l’affectation des ressources humaines, financières, matérielles, etc., en relation étroite bien sûr avec les chercheurs et les travailleurs du secteur.
La voie qu’il faudrait explorer renouerait avec une vieille tradition trop oubliée du mouvement socialiste : la prise en charge de la recherche appliquée, du développement et de la production des médicaments par les mutuelles et coopératives, par les caisses de sécurité sociale (désétatisées), par le monde associatif, enfin par tous les acteurs non spéculateurs et non capitalistes qui pourraient mobiliser une part importante de l’épargne volontaire et une part des cotisations sociales dans l’innovation et la production. On voit mal pourquoi, par exemple, l’Économie sociale et solidaire ne commencerait pas à prendre toute sa part et ses responsabilités dans ces activités. Quant aux délibérations, expertises, et décisions, elles ne pourraient qu’être issues de la société elle-même dans le cadre d’institutions démocratiques adéquates, dont l’actuel Conseil économique social et environnemental n’est qu’une très pâle esquisse.
- Les brevets comme enjeux de propriété et de pouvoirs
MBC : La revendication des « communs » se développe face au renforcement de la propriété intellectuelle (PI), par les accords de libre-échange ADPIC à la création de l’OMC en 1994, consacrant l’exclusivité de monopole des brevets et leur légitimation mondiale. La justification n’en est pas de préserver l’innovation et son concepteur. Le brevet est un outil de concurrence et de réservation des marchés. La pandémie Covid-19 met dramatiquement à nu le danger de laisser le contrôle des ressources stratégiques comme « la connaissance », aux seules entreprises, qui s’en servent pour se livrer une concurrence destructrice.
Nous nous posons donc légitimement la question : dans quelle mesure le principe du commun peut-il devenir un axe du droit à l’échelle mondiale, qui s’impose aux États et aux institutions internationales ?
CL : Vous avez raison de vous poser la question… et nous nous la posons nous-mêmes ! Mais blague à part, ce qui nous frappe Pierre Dardot et moi-même, c’est le remue-méninge parmi les juristes autour de cette nouvelle conception de la politique du commun, ce qui se traduit par une recherche tous azimuts – j’avoue que j’ai du mal à suivre- de nouveaux outils d’analyse et de concepts visant à créer quelque chose comme un droit du commun à l’échelle mondiale. Il suffit de parcourir l’étonnant Dictionnaire des biens communs sous la direction de Marie Cornu, Fabienne Orsi et Judith Rochfeld (près de 1400 pages !) pour se rendre compte de la richesse des recherches juridiques et politiques contemporaines et de l’intensité de la circulation des idées partout dans le monde. J’y vois l’effet des mouvements sociaux, des expérimentations, des mobilisations qui depuis vingt ou trente ans ont investi le champ normatif pour contester la mondialisation capitaliste.
Cette contestation a fait apparaître que le capital s’était doté de ses propres outils juridiques, de ses lieux de production de la norme, de ses chambres d’arbitrage, enfin de toute une armature juridico-institutionnelle qui lui a assuré une expansion sans limite depuis des décennies. Mais ces mouvements de résistance et de contestation ont compris que le droit n’était pas seulement l’arme des forts, et qu’il ne pouvait pas se réduire à réaffirmer le pouvoir des États nations. La difficulté ici tient à ce qu’une nouvelle normativité du commun mondial a besoin d’institutions alternatives, ce que les juristes ont parfois un peu tendance à oublier. D’où peuvent-elles naître ? De la transformation des institutions interétatiques actuelles en institutions mondiales ? De la coopération de certains États qui seront bien obligés de définir des politiques communes pour faire face aux défis posés à l’humanité ? De la transcroissance de mouvements transnationaux qui deviendraient réellement instituant ? Il est encore tôt pour le dire.
MBC : Lors d’un récent entretien avec la revue ContreTemps[2], votre interrogation nous interpelle : « Comment des entités construites pour la rivalité interétatique ou pour la guerre économique permanente pourraient-elles devenir des instruments d’une coopération mondiale au sein de laquelle chaque peuple aurait à sa disposition les biens communs satisfaisant les droits les plus fondamentaux ? » …Vous parlez « d’une « politique du monde » qui n’est pas un énième projet de réorganisation des institutions du monde, mais une politique qui a ici et maintenant le monde pour horizon et enjeu. »
Comment appréhendez-vous dans cette optique la question du dépassement des brevets ? Est-ce un « bon angle » d’attaque pour permettre un accès universel aux médicaments (prix équitables) ?
On voit, avec la crise des vaccins contre la covid-19, que les brevets sont l’un des freins à l’amplification de leur production et à leur mise à disposition mondiale. Lors d’un récent entretien[3], Maurice Cassier, nous a fait part de ses réflexions pour répondre aux urgences de la situation actuelle. Qu’en pensez-vous ?
CL : Bien sûr, s’attaquer aux brevets revient à s’attaquer au principe même de la propriété. Les brevets ne doivent pas être l’occasion de rentes de situation, surtout dans des cas d’urgence sanitaire qui touche toute la planète. S’il est normal que les chercheurs soient bien rémunérés et même récompensés, que les investissements privés soient couverts, il est par contre tout à fait anormal que des actionnaires qui ne sont pour rien dans la découverte d’une molécule ou dans la mise au point d’un vaccin, souvent d’ailleurs avec l’appui des autorités publiques, s’enrichissent comme ils le font à l’aide de brevets. Les Big Pharma – la branche santé du capitalisme concentré d’aujourd’hui-, doivent être mis sous contrôle des citoyens. Et pour ce faire, il faut imposer des règles mondiales qui raccourcissent drastiquement la durée du brevet, obligent au partage avec les entreprises productrices et les autres pays, ou bien encore créent de nouveaux outils juridiques à l’instar du copyleft dans le domaine numérique.
En un mot, brevet et bien commun obéissent à des logiques antinomiques. Les gens qui parlent de « bien commun » sans mettre en cause la logique du brevetage sont inconséquents. Mais le plus étrange dans la situation que nous vivons est que les outils dont disposent déjà les États ne sont pas mobilisés. Les accords ADPIC de 1994 dont le but étaient d’étendre et de protéger la propriété intellectuelle, prévoyaient déjà des exceptions dans son article 31 « dans des situations d’urgence nationale ou d’autres circonstances d’extrême urgence ou en cas d’utilisation publique à des fins non commerciales ». On est vraiment dans ce cas-là. Il aurait suffi d’ailleurs de brandir ces possibilités pour obtenir des conditions commerciales bien plus favorables. C’est le principe des licences forcées, dont on ne voit pas aujourd’hui le début de mise en œuvre, même si des États commencent à en parler. Sur ce point, on ne peut qu’être entièrement d’accord avec Maurice Cassier [4](cf. citation).
4. Sortir de l’alternative entre marchandisation et régulation étatique
MBC : Si la logique du « commun » vise à s’extraire de la domination privée capitalistique, elle n’est pas pour être confisquée par l’État. D’autant que l’État est devenu captif du pouvoir des Big Pharma. Avancer vers le « médicament bien commun », vers une appropriation sociale de cette chaîne, de la recherche à la production et à la distribution, ne peut se décréter d’en haut. C’est un processus de mobilisation des forces diverses de la société, dans tous les domaines concernés.
Comment ne pas reproduire l’échec des expériences précaires des nationalisations de 1981, lié en particulier à l’absence de démocratie sociale ? Comment l’association, l’intervention et les pouvoirs, des principaux intéressés : patients, professionnels de la santé, salariés, citoyens, élus, peuvent-ils être effectifs ?
CL : Ce que vous suggérez là fait toute l’essence de ce que nous appelons le « commun de santé », c’est-à-dire un grand service public de la santé, comprenant un pôle industriel, qui échappe à la tutelle verticale de la haute fonction publique dont on a vu à quel point elle était liée aux intérêts capitalistes et imprégnée de la doxa néolibérale. Chaque grand secteur d’activité qui participe au bien vivre de la population doit être réorganisé de sorte à ce qu’il soit gouverné par une coalition d’acteurs directs, d’usagers et de citoyens, selon des formes institutionnelles à inventer. La force de la mobilisation n’est pas indépendante de ce projet de réinstitution démocratique de la santé, c’est ce qu’il faut comprendre. L’objectif a beau être assez lointain, il peut être travaillé dès aujourd’hui dans les syndicats, les associations de professionnels et d’usagers. Il faut reprendre en main l’avenir et ne pas être seulement en « réaction » aux réformes toujours plus nuisibles qui sont imposées aux différents services publics. Pour ma part, je travaille avec des syndicalistes sur un tel projet dans le domaine de l’éducation.
5. La sécurité sociale peut-elle être un levier ?
MBC : Le 21ième siècle est inauguré par la résurgence des épidémies, dont les causes environnementales sont affirmées. Le devenir humain ne pouvant être que collectif, ce siècle devrait s’illustrer par des avancées révolutionnaires en matière de protection sociale. Nous pensons évidemment à la Sécurité sociale, dans son principe fondateur : remboursement à 100% des médicaments et des soins, démocratisation de sa gouvernance pour rendre aux assurés ce qui leur appartient.
Pourquoi ne pas réfléchir à un concept de Sécurité sociale mondialisée à vocation universelle ? Qu’en pensez-vous ? Est-ce un levier essentiel?
CL : Cette idée est exactement dans l’esprit de ma réponse précédente. Cela peut paraître tout à fait utopique, mais il est tout aussi certain que les problèmes qui vont se poser de plus en plus à l’humanité auront une dimension planétaire. Et pourtant nous sommes doublement désarmés. D’une part, nos systèmes de production sont largement dominés par le principe de valorisation du capital, qui est hétérogène à la logique des besoins humains lorsque ces derniers ne sont pas directement solvables. D’autre part, nos systèmes politiques sont étatiques et nationaux pour l’essentiel. Et dans ce double registre, capitaliste et national-étatique, c’est la concurrence qui l’emporte sur la coopération. Le 21ème siècle se présente donc mal pour faire face aux grands dangers qui nous guettent. Et croire que le principe de souveraineté nationale sera la réponse adéquate témoigne d’un aveuglement tristement partagé par beaucoup, y compris à gauche. Encore une fois la question qui se pose à nous touche à notre capacité de création historique et d’innovation institutionnelle. De ce point de vue, il n’est pas inintéressant de mesurer l’audace créatrice des fondateurs de la sécurité sociale nationale. C’est la même qu’il nous faut avoir, mais cette fois pour construire des institutions globales. Et cela suppose que se construisent et se développent des mobilisations transnationales, qui pourraient être les creusets de ces futures institutions.
[1] Commun, Essai sur la Révolution au XXIe siècle, La Découverte, 2015
[2] « Il faut avoir le courage d’aller à contre-courant du nationalisme et du souverainisme », P.Dardot et C.Laval, ContreTemps N°46
[3] Entretien avec Maurice Cassier réalisé par le collectif MBC le 14 Janvier 2021
[4] Maurice Cassier : « Dans ce contexte il est urgent 1) de mettre en commun les brevets, toutes les technologies et savoir-faire pour dépasser les exclusivités de tel ou tel laboratoire ; cela avec des licences d’office ou obligatoires qui existent dans les droits des États et dans les accords internationaux, 2) d’organiser une gestion commune de ces technologies à l’échelle européenne et mondiale pour inventorier tous les laboratoires susceptibles de produire ces vaccins, en facilitant les opérations de transfert de technologie ; 3) d’augmenter les capacités de production en finançant dès aujourd’hui la création de laboratoires publics de fabrication, à répartir en Europe. Ces laboratoires publics pouvant ajouter leurs capacités de production aux laboratoires privés. Il importe plus que jamais, dans le contexte de pandémie, de développer une industrie des vaccins gouvernée par les politiques de santé, qui dépasse les brevets et les marchés exclusifs de tel ou tel laboratoire. »