Restitution de la Rencontre-débat
Organisée par Médicament Bien Commun
Paris, 21 octobre 2023
Introduction de la journée
Éliane Mandine, membre du collectif Médicament Bien Commun (MBC)
Le collectif Médicament Bien Commun est né à la suite du manifeste « pour une appropriation sociale du médicament »écrit en 2018. Le manifeste est consultable en ligne sur le site www.medicament-bien-commun.org, où il est encore possible de le signer.
Dans ce collectif, nous sommes un groupe de militants.es en lutte contre l’extension de la propriété intellectuelle (PI), propriété exclusive, à la connaissance et au vivant, et contre l’extension du marché au domaine de la santé (droit à la santé – soins de santé – médicaments).
PI, propriété privée et marchandisation sont liées. Les produits et soins de santé sont devenus des marchandises relevant du commerce international à la suite des accords de Marrakech, en 1994, légitimant les droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (ADPIC) et leur application aux médicaments. Nous contestons ces accords pour leurs effets négatifs sur l’accès aux médicaments et le droit à la santé.
Ce que nous voulons, c’est que le médicament puisse bénéficier d’un statut juridique particulier, reconnu dans le droit international, qui le rende non appropriable, de sorte qu’il puisse échapper aux échanges marchands, être hors des lois du marché, du profit et de la concurrence. Ce statut pourrait être celui de bien commun. Les soins de santé, les médicaments et les vaccins, parce qu’ils contribuent à garantir l’effectivité du droit à la santé, peuvent prétendre au statut de bien commun. Ce qui permettrait d’aller vers une plus grande égalité d’accès aux soins de santé, dans le cadre d’une solidarité internationale.
Nous mesurons le chemin à parcourir entre ce que nous voulons et ce que nous subissons dans le quotidien : le droit à la santé, l’accès aux soins de santé, ont été confiés aux entreprises privées, lesquelles sont devenues des monstres financiers, en grande partie grâce aux ADPIC, qui, en donnant une exclusivité commerciale aux industries pharmaceutiques (IP), leur ont permis de se positionner en situation de monopole, les brevets s’étant avérés de véritables outils d’accumulation du capital. En témoigne le chiffre d’affaires global de l’industrie pharmaceutique qui pesait 63 milliards d’euros en 2022. Avec une telle puissance financière, les IP peuvent imposer leurs stratégies industrielles et commerciales aux États. Ce ne sont plus les États qui mettent les entreprises en concurrence, mais les entreprises qui mettent les États en concurrence, usant au besoin de chantage, notamment du maintien de l’emploi sur le territoire, pour exiger de meilleurs prix, et plus d’avantages fiscaux. Ainsi les IP bénéficient du Crédit impôt recherche (CIR) à hauteur de 710 millions d’euros.
Par ailleurs, les médicaments sont solvabilisés par la Sécurité sociale : 8 à 9 milliards d’euros par an venant de la Sécurité sociale, sont perçus par le top 5 des IP (Novartis, BMS, MSD, Pfizer, Sanofi). Le modèle d’affaire de la pharmacie actuel est très performant pour dégager de la valeur pour les actionnaires : par exemple, 4 à 5 Mds d’euros par an, pour les actionnaires de Sanofi. Il est beaucoup moins performant pour satisfaire les besoins de santé de la population. Un tiers de la population française est confrontée aux pénuries de médicaments. Les ruptures de stocks ont été multipliées par 300 en dix ans, pour atteindre 3700 en 2023 (selon l’ANSM). Les IP ont annoncé vouloir renoncer à produire 700 autres médicaments.
La production de vieux produits, même lorsqu’ils sont utiles et d’intérêt thérapeutique majeur (MITM), est abandonnée par les IP, qui les considèrent insuffisamment rentables. Les entreprises préfèrent se tourner vers les innovations thérapeutiques (très soutenues par les finances publiques) pour lesquelles elles exigent des prix exorbitants qui les rendent inaccessibles aux plus démunis, et, de plus,grèvent le budget de la Sécurité sociale.Les professionnels de la santé sont obligés de sélectionner les patients pouvant bénéficier du traitement. Exemple du Sovaldi-Sofobuvir, traitement de l’hépatite C : seuls les patients au stade le plus avancé de la maladie ont droit au médicament, afin d’éviter de faire exploser l’enveloppe budgétaire de la Sécurité sociale. Nous avons, d’une part, des pertes de chance lorsque le patient ne peut se procurer le traitement qui lui a été prescrit, et d’autre part, des inégalités de traitement. Ce qui nous amène à considérer le système comme défaillant.
Face à cette défaillance, quelles solutions avons-nous ? Pour « déboulonner » les Big pharma, il faut opposer une certaine force, une puissance, qui nécessite la mise en mouvement de l’ensemble des parties prenantes, depuis les salariés de l’IP jusqu’aux citoyens bénéficiaires des traitements thérapeutiques, en passant par les professionnels de la santé, les syndicats, les politiques. Pour tenter de transformer le mode actuel de production et de distribution des médicaments, il nous faut gagner l’opinion publique et pouvoir compter sur une volonté politique forte.
L’objet de notre rencontre aujourd’hui est de mettre en débat les possibles alternatives au système actuellement en place : comment imposer les changements, quelles actions entreprendre, quelles démarches, quels leviers mobiliser ? Notre souhait est qu’en fin de journée, nous ayons quelques pistes de travail, quelques perspectives pouvant donner naissance à une dynamique collective de travail à un projet alternatif commun.
Nous avons prévu deux tables rondes :
- Une première, consacrée à comprendre et analyser les enjeux du modèle économique actuel, avec quatre intervenants. Thierry Bodin en est l’animateur. Il présentera chacun des intervenants.
- La deuxième table ronde porte sur des propositions alternatives de production de médicaments, avec également quatre intervenants. L’animatrice est Danielle Sanchez. Elle présentera les intervenants.
Entre les 2 tables rondes, en fin de matinée, nous avons réservé un temps pour aborder une alternative particulière, qui est l’approche par les communs. Nous avons demandé à un pionnier des communs, Frédéric Sultan, de venir nous en parler. Je le remercie beaucoup d’avoir accepté notre invitation.
Les communs, les biens communs sont de plus en plus souvent évoqués, parfois à tort et à travers. Il existe un risque de récupération de l’idée des communs, de commonwashing, au même titre que le greenwashing.
Faire un point sur ces notions nous semble important. Elles ne sont pas toujours bien comprises, notamment dans leur dimension politique de transformation. Dire que la santé est un bien commun, ou que le médicament est un bien commun, ou encore que la Sécurité sociale est un bien commun, qu’est ce que cela signifie? En provocation, je dirai qu’il s’agit de passer d’une société marchande régulée par le consommateur via le mécanisme des prix, à une société plus inclusive associant les citoyens. C’est à débattre.
***
1re table ronde
La caractérisation du modèle économique du médicament
dans ses dimensions économique, sanitaire et sociale.
Le rôle de la propriété intellectuelle et l’application des brevets.
Animée par Thierry Bodin, membre du collectif MBC, ancien syndicaliste Sanofi.
Thierry Bodin
Pour comprendre les enjeux du modèle économique actuel et ses conséquences pour les populations, nous avons sollicité 4 invités :
- Fabien Mallet, coordinateur CGT du groupe Sanofi, nous fera part des choix stratégiques du groupe Sanofi et ses conséquences pour les salariés et les patients ;
- Laurence Cohen, sénatrice communiste groupe CRC ; durant 12 années, a assuré la vice-présidence de la commission des affaires sociales. Son dernier rapport sur les pénuries de médicaments et les responsabilités des Big pharma, a fait grand bruit. Elle nous fera part de son analyse et de la conception de son engagement sur cette question ;
- Michael Sankara, avocat, auteur d’une thèse sur l’accessibilité des médicaments dans le contexte du commerce international, nous parlera des moyens délétères utilisés par les laboratoires pharmaceutiques, concernant les brevets et les droits de propriété intellectuelle, pour empêcher la concurrence et maximiser les profits ;
- Christophe Prudhomme, médecin urgentiste et syndicaliste, nous exposera la réalité du vécu à l’hôpital par les personnels de santé et les patients, les difficultés d’accès aux soins, les prix élevés des médicaments et plus généralement notre système de santé mal en point, de par les choix des gouvernements successifs.
A l’issue de ces 4 interventions, vous pourrez poser vos questions à nos intervenants.
Je vais donc passer la parole à Fabien Mallet.
Ces dernières années, Sanofi a été sous les feux des médias, plus particulièrement à propos des vaccins anti-Covid mais aussi des restructurations incessantes. En tant que syndicaliste, comment analyses-tu cette stratégie des dirigeants et ses conséquences pour les patients et les salariés ?
***
Fabien Mallet, coordinateur CGT du groupe Sanofi
Pourquoi les pénuries de médicaments, vu de l’intérieur d’une Big pharma
Même si Sanofi a son siège social en France, c’est une multinationale. Qu’on arrête de dire que Sanofi est français : avoir le siège social en France ne suffit pas pour dire que l’entreprise est française. Le CA de Sanofi est de 41 milliards d’euros, son bénéfice net de 9 milliards d’euros. Historiquement son cœur de métier est la pharmacie d’usage, dont le produit le plus connu est le Doliprane, les vaccins et l’oncologie, qui disparaît petit à petit.
C’est une société dirigée par des actionnaires : ce n’est pas Paul Hudson le patron, c’est le « pack » d’actionnaires Sanofi qui a recruté un mercenaire appelé Paul Hudson pour venir diriger la société.
A sa création, ex-Roussel-Uclaf-Aventis-Sanofi-Synthélabo, fleuron de la recherche et de l’industrie pharmaceutiques, le groupe avait pour objectif d’assurer l’indépendance de la France dans le domaine. C’est l’époque d’Elf et compagnie. Depuis on est passé du fleuron à un système bancaire, c’est-à-dire que c’est une entreprise qui est gérée comme une banque, pour rapporter le plus d’argent possible, avec, pour conséquences des abandons successifs de différentes parts de marché (selon les patrons), plus précisément de soins pour les patients (selon les syndicats).
Les conséquences de cette stratégie sont visibles : vous avez pu le constater avec la pandémie ! Sanofi, historiquement, est un leader des vaccins. On s’attendait à ce que Sanofi soit à l’appel face à cette nouvelle pandémie, eh bien non ! Ceci s’explique par une réduction de la puissance de recherche, divisée par 7 entre 2012 et aujourd’hui. L’entreprise est passée de 22 sites à 8, le nombre de chercheurs a été divisé par 7. Donc s’il n’y a plus de chercheurs, c’est difficile de trouver. Depuis 2012, la stratégie est celle des actionnaires. Le pack d’actionnaires a décrété que Sanofi devait être rentable à hauteur de 2 chiffres pour le bénéfice net par action ; chaque année vos actions vous rapportent un peu plus que l’année précédente, le montant fixé devant être de 10% au moins chaque année.
Deux façons pour arriver à cela : soit être de petits génies de l’innovation, capables de sortir un nouveau médicament tous les 6 mois ; soit vous décidez que la recherche coûte trop cher (payer les chercheurs, leur fournir les locaux…), donc vous élaguez un peu tout, pour ne garder que ce qui rapporte. C’est l‘option deux qui a été choisie. De ce choix, Sanofi est devenue une entreprise qui n’a plus de pieds pour marcher. Ils ont d’abord détruit la recherche ; ils sont en train de détruire les outils industriels. C’est une volonté actionnariale, pour que les actions rapportent plus chaque année, qui conduit à détruire un outil de santé. Pour nous syndicalistes, Sanofi est un outil de santé car le cœur de Sanofi est de faire des médicaments pour soigner.
Si on revient à la pandémie, les dirigeants de Sanofi expliquent que c’est une « grippette », cela va passer, pas utile de mettre des moyens pour cela. Neuf mois ont ainsi été perdus. Quand les dirigeants réalisent que c’est une épidémie mondiale qui tue, Sanofi essaie alors de sortir un vaccin. Mais quand il n’y a plus de chercheurs, vous ne pouvez rien sortir. C’est là qu’on s’aperçoit que le roi est nu. Bricoler un vaccin, comme on savait le faire il y a 25 ans, ne suffit pas face aux technologies modernes utilisées par d’autres labos. Ce qui n’a pas empêché Sanofi de recevoir des millions de la part de l’UE et des États-Unis, pour finalement sortir un vaccin sous une forme pas efficiente, ce qu’on savait dès le départ.
Autre exemple, parlant et plus cynique, c’est l’arrêt de l’Immucyst, un vaccin (BCG) surdosé utilisé pour soigner le cancer de la vessie. Ce vaccin était fabriqué par une petite usine au Canada, que le pack d’actionnaires a considérée comme trop coûteuse. Elle a été fermée, sans que la production du vaccin ne soit rapatriée ailleurs. Aujourd’hui, il est démontré que le fait qu’Immucyst n’existe plus a un impact non négligeable sur le nombre de décès par cancers de la vessie – fortement quantifiable. Et cela, à la suite d’une décision des actionnaires qui ne veulent pas faire ce qui ne rapporte pas assez. Le vaccin n’étant plus breveté, tout le monde peut le produire (production peu chère) ; le nombre de cancers de la vessie n’étant pas suffisamment élevé, etc.
Pour conclure, je voudrais rappeler notre positionnement syndical, celui de la CGT. La bataille, que nous menons en interne, est de dire que ce qui nous intéresse chez Sanofi, c’est que l’entreprise ait des usines qui produisent des médicaments pour les patients, et réponde aux besoins des patients. C’est cette orientation syndicale qui s’oppose aux décisions d’abandon des médicaments, même quand ils sont jugés trop vieux, inutiles, plus rentables. Le but n’est pas d’être rentable, mais de soigner. La CGT est le premier syndicat au sein de l’IP à porter l’idée du pôle public du médicament, ce qui nous est reproché par la direction (créer un concurrent à Sanofi !). Sanofi est aujourd’hui une entreprise sans chercheurs, ou quasiment, qui est en train de se déshabiller complètement. Quand on nous explique que c’est par Sanofi, un fleuron de l’IP, que la souveraineté européenne du médicament va être réalisée, j’ai envie de dire : » Bon courage ! «
***
Thierry Bodin
Laurence [Cohen], au travers de ton mandat, tu as pu interroger des dirigeants de l’industrie pharmaceutique, mais aussi, heureusement, des syndicalistes et professionnels de santé. Au cours de diverses commissions d’enquêtes, tu as pu recueillir un grand nombre d’informations sur les choix délétères conduisant à l’explosion des pénuries de médicaments, mais aussi des prix des médicaments nouveaux. Peux-tu en quelques minutes nous livrer ton analyse de la situation ?
***
Laurence Cohen, sénatrice
Modèle économique du médicament dans toutes ses dimensions
***
Thierry Bodin
Michael Sankara, vous avez, au cours de votre travail de thèse, mis en évidence les techniques utilisées par l’industrie pharmaceutique pour contourner la faible réglementation existante, en vue d’empêcher la concurrence et pour maximiser les profits, et qui a eu pour conséquence de priver des milliards d’individus des traitements adaptés. Vous rappelez que l’accès aux médicaments est un droit et une obligation. Je vous cède la parole.
***
Michael Sankara, avocat
Focus sur la propriété intellectuelle et son rôle pivot du modèle économique de l’industrie pharmaceutique.
***
Thierry Bodin
Je vais maintenant laisser la parole à Christophe Prudhomme pour exposer son analyse de la situation concernant la pénurie de médicaments et, plus généralement, sur l’état de notre système de santé.
***
Christophe Prudhomme, médecin urgentiste au SAMU 93 de Bobigny
Entre les prix élevés et les pénuries, les difficultés d’accès aux soins
Avec les médicaments, on est au cœur du réacteur. La question est : est-ce que la santé relève du service public et est-ce que l’on respecte le droit constitutionnel du droit à la santé pour tous ? La santé est un droit constitutionnel ; c’est inscrit dans le préambule de la constitution de 1946 et repris dans la constitution de 1958. C’est donc à l’État d’assurer ce droit à la santé pour tous. Or l’État est défaillant pour assurer ce droit effectif. Ce n’est pas si vieux que cela, que les choses ont changé : la brevetabilité date de 1967. L’Insuline (1922 – ndlr) a été mise par leurs découvreurs à disposition mondiale. Si elle avait été brevetée, quelle catastrophe sanitaire !
Aujourd’hui, il y a une stratégie très bien organisée, avec une duplicité totale du gouvernement vis-à-vis de l’industrie pharmaceutique. Cette duplicité ne date pas d’hier mais elle s’accentue avec le gouvernement Macron, qui est un ultralibéral, là pour faciliter le monde des actionnaires, qui sont ses amis et ont financé sa carrière politique.
Sous la pression du rapport de la commission sénatoriale sur les pénuries de médicaments, le gouvernement, dans le débat sur le projet de loi de financement de la Sécurité sociale déclare qu’il va prendre des mesures, notamment pour la production de médicaments par les pharmacies hospitalières (il est prévu une augmentation des effectifs pour répondre à cette production) ; ou l’exemple de la production d’Amoxicilline par une pharmacie parisienne qui sait faire des préparations magistrales.
Pourquoi ? Parce que produire les médicaments essentiels n’intéresse pas l’industrie pharmaceutique. Laisser au privé ce qui est rentable, donner au public ce qui ne l’est pas.
Il y a conjonction entre les gouvernements libéraux et les médias, qui utilisent la population pour aller dans le sens de l’industrie pharmaceutique. L’appel à se faire vacciner contre le Covid est une publicité Pfizer et non plus une annonce du Ministère de la santé ! Au journal télévisé est annoncée l’arrivée d’un nouveau médicament, alors que nous, médecins, n’avons pas l’information. Et sur cette avancée thérapeutique annoncée, nous ne pouvons pas avoir d’éléments car les différentes lois françaises et européennes du droit des affaires permettent de ne plus fournir aux médecins l’intégralité des études.
Lorsqu’on se réfère aux experts indépendants, qui sont très peu nombreux, comme la revue Prescrire, par exemple, on se rend compte que les innovations thérapeutiques sont très peu nombreuses. Alors que les médicaments essentiels, tels le Paracétamol (ex Doliprane), sont vendus à 1,16 € la boite de 8 comprimés de 1g, un anticancéreux, c’est 4 500€ l’ampoule. Le cancer est la première cause de mortalité. L’administration de nouveaux traitements pour prolonger la vie des patients de quelques mois, avec de nombreux effets secondaires, pouvant nuire à la qualité de vie du patient, peut poser des problèmes éthiques. Mais les associations de patients font pression pour prescrire. Il y a un problème avec les associations de patients. Alors que le paritarisme a été cassé à la Sécurité sociale, les associations de patients y sont entrées. Et dans le budget de la Sécu il y a une ligne « financement associations de patients » ! Ils sont donc peu revendicatifs, pour un certain nombre, s’ils veulent conserver leur subvention. Sans compter que, bien souvent, leur subvention est complétée par l’industrie pharmaceutique, de manière détournée, par le biais d’ associations, qu’elle a créées et qu’elle finance. Il y a donc des dérives problématiques.
Je reviens sur mon métier d’urgentiste : dans les véhicules du SAMU, nous avons besoin de 30 médicaments, la plupart ne sont plus brevetés. Ces sont des médicaments très efficaces, et nous rencontrons des difficultés à maintenir notre pharmacie parce que, régulièrement, l’industrie pharmaceutique nous informe de difficultés de fabrication : la Digitaline, par exemple (molécule de traitement cardiaque très efficace), parce que la digitale importée d’Inde n’est pas de bonne qualité. On est donc obligé de bricoler. En Seine-Saint-Denis on vaccine les enfants contre la tuberculose : Sanofi n’a plus la capacité de fournir ces vaccins, on doit donc importer de Pologne des flacons multidoses, au lieu des seringues unidoses, ce qui complique le travail. Aujourd’hui, il faut être clair : Il y a quelques années, avec une collègue pharmacienne, nous avons écrit un article sur « 100 médicaments pour tout soigner en médecine de ville ». On n’a pas trouvé les 100 médicaments…
L’éducation populaire est importante car il y a des bons et des mauvais médicaments. Quels sont les médicaments utiles, pour lesquels il faut se battre ? Quels sont ceux dont on doit éliminer l’autorisation de mise sur le marché ? On a des ordonnances longues comme le bras qui posent problème : 10% des urgences sont dues aux effets secondaires et interactions entre traitements médicaux. On prescrit trop. Le problème n’est pas de produire toujours plus mais de produire mieux et justement rémunéré.
A Romainville, il existait une entreprise pharmaceutique, Roussel-UCLAF (1920 – 2004 ndlr). Elle a mis au point le Claforan, un antibiotique très actif. Aujourd’hui, il y a de nombreuses multirésistances aux antibiotiques existants et Sanofi a abandonné les recherches en antibiothérapie. Or les maladies qui tuent le plus au niveau mondial, ce sont les maladies infectieuses. Les recherches sont orientées vers des médicaments qui peuvent être vendus très chers (régénération des cartilages par exemple).
Le problème est plus global : oui au pôle public du médicament, mais il faut y inclure la recherche. Car les ultralibéraux sont très organisés. La loi Sarkozy sur la réforme des universités a créé les instituts hospitalo-universitaires, qui sont des structures de droit privé, dont le personnel est en partie sous statut public. Mais ces instituts sont adossés à des fondations créées par les universités, qui récoltent des fonds et des dons auprès des industriels. L’industrie pharmaceutique est très intéressée car cela lui permet d’avoir un outil de recherche pour pas cher. De plus, l’industrie influence les orientations des sujets de recherche car « qui paie décide » ! Ils ont donc mis en place un système permettant à l’industrie d’utiliser la recherche universitaire et de fermer ses propres structures. Par exemple, le Zolgensma, molécule mise au point par les équipes du Généthon sur fonds publics et dons du Téléthon, est récupéré par Novartis.
Donc, aujourd’hui, nous avons besoin d’un pôle public de recherche et de production de médicaments, identique pour les essais cliniques, qui sont aussi orientées au plus rentable.
On doit mener un débat avec les médecins, pour qu’ils travaillent différemment, avec la population, pour qu’elle soit consciente de ce que sont les médicaments, à quoi ils servent, que l’on a besoin de médicaments de qualité mais que les axes privilégiés par l’industrie sont sur les médicaments rentables, vendus en grande quantité, dans les pays riches et développés, et surtout lorsqu’il y a une solvabilisation comme la Sécurité sociale. Là, c’est bingo !
Aujourd’hui, un médecin généraliste « coûte » à la Sécurité sociale un peu moins d’un million d’euros (150 000 pour sa rémunération, 750 000 pour les examens et les médicaments qu’il prescrit). Trop de prescriptions, trop d’examens, alors qu’il faut rendre du temps aux médecins pour qu’ils puissent travailler sur la prise en charge globale du patient. « La santé est un état de bien-être physique, mental et social, et ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d’infirmité » (extrait de la constitution de l’Organisation mondiale de la santé – ndlr). Pour redonner du temps au personnel soignant, il faut sortir de la rémunération à l’acte, qui est un échec constaté dans le cadre des négociations conventionnelles – c’est une revendication de la CGT.
On a changé de système de santé entre le 20ème et le 21ème siècle. Deux tiers des dépenses de la Sécurité sociale, aujourd’hui, ce sont pour des patients de plus de 50 ans atteints de maladies chroniques. La prise en charge globale ne peut pas être assumée par le médecin seul, c’est un travail pluriprofessionnel, il faut une équipe (infirmière, kiné, orthophoniste, etc.). Et ces structures multi-professionnelles s’appellent centres de santé, même s’ils sont dévoyés par le privé, qui a bien compris les profits qu’il peut en tirer via la Sécurité sociale (voir les scandales).
Il faut un meilleur contrôle sur ce que l’on prescrit et, en particulier sur les médicaments, c’est lié à la manière dont l’information est donnée par l’industrie, dont les médecins sont tributaires. Les agences mises en place : ANSM, HAS, ne sont pas efficaces. Il doit y avoir un organisme indépendant qui donne l’information aux professionnels de santé sur la qualité des médicaments. La Sécurité sociale devrait mettre en place une structure paritaire d’information sur les médicaments, pour avoir une information fiabilisée, indépendante des laboratoires privés. Le chemin à parcourir est long, mais aujourd’hui au regard des scandales qui se succèdent…
Ma conclusion : monsieur Macron nous propose des référendums. Eh bien : « Banco ! ». On propose un référendum simple, avec une question : est-ce que le domaine de la santé doit relever exclusivement du service public et d’un financement public et en exclure toutes les activités marchandes ?
Si on pose cette question, avec tous les scandales, les dérives de l’industrie pharmaceutique etc., ce referendum, on le gagnerait, largement, et le Conseil constitutionnel, la législation européenne, on leur coupe l’herbe sous le pied. Partons de la réalité concrète auprès des populations et des professionnels, posons les questions d’une manière claire, pour une politique de rupture réelle vis-à-vis du capitalisme. Parce que capitalisme et droit à la santé, aujourd’hui, c’est antinomique.
***
La discussion
D’emblée, une participante précise que le lobby de l’industrie pharmaceutique atteint jusqu’au Président de la République, puisqu’Emmanuel Macron est lié aux actionnaires de Sanofi. On parle d’une nécessaire éducation populaire, car beaucoup de gens ne comprennent pas comment fonctionne notre système de santé. Des confusions se sont installées jusque dans la considération de la carte vitale (prise pour une carte de paiement).
Elle souligne que l’on n’arrivera pas collectivement à arrêter les multinationales, si l’on n’a pas une masse de citoyens suffisante pour changer le système. C’est pour cela que ce genre d’initiatives est important et qu’il faut les multiplier. Pour comprendre comment fonctionne l’industrie pharmaceutique, il faut revenir à la base du capitalisme. Il y a une spoliation du droit à la santé à des fins de profits. Il est nécessaire de différentier innovation et marketing. Des recherches sont également méconnues, comme celle, aujourd’hui non exploitée, de la fabrication et de la conservation de l’insuline par un procédé qui n’utilise pas de gros moyens de maintien au froid. Cela fait 50 ans que l’on sait faire une insuline qui se conserve sans froid et aucune IP ne le fait. Les salariés de Sanofi savent faire mais le groupe ne veut pas faire. En revanche, l’utilisation du curcuma pour la protection des cartilages est devenue un nouveau filon de ressources financières.
Il est aussi question de revoir les financements, ainsi que les rôles respectifs de l’OMS et de l’ONU. Le bilan de l’OMS n’est pas brillant, est-il réformable ? L’OMS et l’OMC sont au service des multinationales, puisqu’elles les financent. C’est aussi le cas de nombre de fondations, qui vivent par le financement de dons des États et de sociétés pharmaceutiques. Le problème de l’OMS, c’est le problème de l’ONU, puisque ce sont les États qui financent donc qui font pression. Pendant le 20e siècle, l’OMS a travaillé à des perspectives mondiales progressistes. Aujourd’hui, cela ne fonctionne plus car les nominations par les États ne permettent pas à l’OMS d’être dans une dynamique progressiste pour le système de santé mondial. Il va falloir trouver autre chose.
Laurence Cohen précise que la commission du Sénat a fait l’objet d’un bras de fer avec Bercy, car les personnes n’ont pas la capacité de communiquer des informations rapidement et facilement exploitables. Ce sont des organismes qui travaillent en silos, sans liens transversaux. Un certain nombre de grands groupes font de l’optimisation fiscale. Il faut être clair : il y a une différence entre les Big pharma et les petits labos qui cherchent à faire autrement mais auxquels on met des bâtons dans les roues. Il faut un pilotage politique clair, un secrétariat en lien direct avec le premier ministre par exemple. La Sécurité sociale a été dans l’incapacité de nous fournir le coût de la pénurie de médicaments, ni en termes de santé publique ni en termes de coût financier pour la Sécu.
Les grands labos dépensent des milliards dans le marketing et la publicité (20 à 25% du CA), avec un manque de transparence sur le prix des médicaments. Les négociations avec le Comité économique des produits de santé (CEPS) s’annoncent « transparentes » mais les coûts de R&D et de fabrication sont masqués.
***
Danielle Sanchez, membre du collectif MBC
Après avoir caractérisé le modèle économique du médicament dans ses dimensions économique, sanitaire et sociale, le rôle de la propriété intellectuelle ou l’application des brevets, avec l’aide de nos 4 intervenants de la matinée, nous allons aborder le thème de la seconde table ronde de cet après-midi : « Quelles approches possibles pour rendre le médicament non-appropriable ».
Nous avons demandé à Frédéric Sultan, animateur du réseau Remix The Commons, d’introduire en fin de matinée ces alternatives possibles, par l’approche des communs – ou : comment et selon quelles conditions sortir du paradigme capitaliste, dans le domaine de la santé et du médicament. En réaffirmant quelques principes mais aussi en détaillant plus concrètement d’autres modes d’organisation et de partenariats pour construire cette démarche par les communs.
***
Frédéric Sultan, animateur du réseau Remix The Commons
Introduction à l’approche par les communs comme modèle alternatif au modèle économique capitaliste sur cette question de la santé et du médicament
Effectivement, on y est. On travaille ensemble depuis maintenant presque 2 ans ou quasiment 2 ans sur l’idée de produire des médicaments comme des communs.
Je ne suis pas, malgré ce que tu disais tout à l’heure, Eliane, le pape des communs, bien sûr. Je ne vais pas vous faire une présentation théorique ou un grand discours sur les communs.
Remix ( https://www.remixthecommons.org ) est une organisation qui a une quinzaine d’années, qui vient des mouvements sociaux et qui est fortement ancrée dans des enjeux et des pratiques démocratiques de l’éducation populaire. Elle travaille sur l’acculturation et la politisation des communs d’une manière générale mais pas particulièrement sur les problèmes de santé et des médicaments, même si, au sein de l’organisation, Gaëlle, par exemple, a beaucoup travaillé là-dessus. Remix vient d’une organisation qui s’appelait VECAM, qui a beaucoup travaillé sur la propriété intellectuelle, les accords ADPIC, dans les années 90 – 2000.
Je ne vais pas répondre à la question : « Qu’est-ce que c’est qu’un médicament en commun ? » puisque, si on le savait, on ne serait pas là, on serait en train de mener des campagnes pour, justement, aller vers des référendums ou des choses comme ça. Pour l’instant, on est en train de rechercher, d’essayer d’expérimenter dans ce sens-là. Cependant, ce que je vais essayer de faire, c’est de vous montrer un peu l’état de notre réflexion et peut être d’apporter aussi des pistes, des questions qu’on pourrait discuter, chercher, expérimenter, essayer de travailler tous ensemble.
Pour moi, l’enjeu, quand on parle de médicaments comme bien commun, c’est effectivement de mettre à disposition de chacun et de chacune les produits de santé dont il ou elle a besoin, dans des conditions de production qui soient satisfaisantes du point de vue écologique, du point de vue social et du point de vue économique aussi, bien sûr, pour à la fois, protéger la société et en même temps la planète. C’est l’horizon qu’on se donne.
Aujourd’hui, je vais repartir de plus loin. Plonger sur le processus ou le cycle du médicament ? J’ai a essayé, avec des gens d’origines, de métiers, de pratiques différentes, de regarder, au fond, comment le médicament se fabrique, de quoi ça part et comment ça fonctionne ? J’ai regardé sur Internet pour voir si je trouvais des compléments à notre appréhension de ce cycle. Et puis en fait, tout ce qui était sur Internet, c’étaient des trucs produits par le LEEM. Ce n’était pas forcément la bonne solution. Ce qui m’intéresse, c’est de mettre en évidence finalement les 4 ou 5 grandes étapes qui sont importantes dans la production de médicaments. On l’a dit tout à l’heure, c’est la recherche, c’est le développement, la production, la commercialisation et la consommation. Volontairement, j’utilise le terme de commercialisation et de consommation, qui sont articulés autour ou qui sont gérés, d’une certaine manière, à partir d’un mécanisme de fixation de prix, et d’un mécanisme de socialisation des coûts, qui est, en France, le système de protection sociale qu’on connaît mais qui va être ailleurs différent.
En fait, si on veut en sortir et si on veut parler de médicament bien commun, ce qu’on veut, c’est d’abord sortir du marché, sortir les médicaments du marché financiarisé en tout cas. C’est peut-être un débat qu’on peut avoir. Entre marché et public, est-ce qu’il y a autre chose ? Est-ce qu’on veut ramener l’intégralité du médicament à du service public et sa production dans le service public ? C’est une question qu’il faut se poser. Mais, en tout cas, ce sur quoi on est certainement d’accord, c’est de sortir du marché financiarisé. Ce qui était dit tout-à-l‘heure sur la différence qu’il y a entre les grandes entreprises, les Big Pharma et les autres, on ne peut pas en faire fi. C’est pour ça que j’insisterai là-dessus.
La 2e chose, c’est que, bien entendu, on veut replacer au centre la question de la santé publique et non pas de la production du médicament comme un bien de consommation. Aujourd’hui, on est dans une situation où sont produits principalement des biens de consommation et les exemples qui ont été donnés tout à l’heure sur les innovations de Sanofi sur le curcuma sont, d’une certaine manière, une démonstration de ça.
Alors à partir de là, on a eu cette discussion-là ensemble, et on peut l’approfondir, clairement. La question de la gratuité du médicament, ça ne suffit pas. Il ne s’agit pas aujourd’hui simplement de dire que le médicament doit être gratuit pour résoudre ce problème. Tout-à-l’heure je ne sais plus qui disait « la carte vitale, c’est une espèce de carte bleue avec laquelle on a le médicament ». En tout cas, on a utilisé cette image-là. Je crois que la question n’est pas seulement de rendre le médicament gratuit. La question, c’est : comment peut-on produire un médicament dans un système différent, dans une économie différente, qui serait une économie fondée sur les communs. A quoi ça pourrait ressembler, si on bascule ?
Au début du cycle de production, on a toujours ce mécanisme de production financiarisée. Et à quoi ça ressemblerait ? Qu’est-ce qu’on veut produire ? Qu’est ce qui peut être en commun, en fait ? Au niveau de la recherche, on sait faire de la recherche ouverte, on sait faire de la recherche en commun, précisément, on sait publier, on sait rendre la recherche commune, si je peux m’exprimer comme ça. Au niveau du développement, on a tout un ensemble, toute une panoplie de choses qui peuvent être l’objet de communs. Ça va être les données, ça va être les recettes des médicaments, ça va être les protocoles, ça va être les souches, et j’en oublie. N’étant pas un spécialiste, je suis certain que si on se mettait autour d’une table et qu’on approfondissait ça, on allongerait cette liste des choses qui peuvent être mises en commun, qui peuvent faire l’objet de communs. Au niveau de la production, il y a bien sûr la technologie, mais il y a aussi toutes les compétences, tous les savoir-faire qui sont autour de cette technologie. On a beaucoup discuté entre nous de ce à quoi ressemble une usine, de quoi on a besoin pour fabriquer un médicament. Basculer ces machines dont on parle en communs, ça peut vouloir dire faire, comme aujourd’hui l’Atelier paysan, qui fabrique avec les paysans des machines qui permettent à chacun de transformer la production alimentaire.
Bien sûr, il y a des questions d’échelle et des questions de finesse et de dimensions technologiques. Mais pour autant, ce n’est pas certain. Enfin, ce sont des questions qu’il faut vraiment se poser. C’est à dire que, quand on parle de médicament bien commun, ce n’est pas seulement la molécule qui n’est plus placée sous un régime commercial, mais c’est en fait tout un ensemble de choses qu’il faut regarder. Quand on regarde du côté du rapport commercialisation/consommation, on cherche quelque chose d’autre qui soit basé sur l’usage, basé sur la satisfaction des besoins et sur des systèmes de protection sociale. Là, il y a vraiment quelque chose à creuser, parce qu’encore une fois, on ne peut pas séparer la dimension de la production industrielle du médicament de la manière dont il va être distribué et utilisé par les malades ou les travailleurs de santé. Ça veut dire qu’il y a un certain nombre d’infrastructures et, aujourd’hui, on en a nommé un certain nombre, qui sont les infrastructures du marché : le système boursier, mais aussi tout un tas de dispositifs et de systèmes qui lui sont importants et dont on peut se rendre compte. Et il faut que l’on remplace des infrastructures d’aujourd’hui du système de santé et du système de production du médicament par de nouvelles infrastructures qui répondent à la question des communs. J’y reviendrai un petit peu plus tard, mais il y a au moins toute la question autour des dispositifs d’approvisionnement, de distribution, et de retraitement du médicament lui-même mais dans les 2 sens, c’est à dire à la fois quand il est fabriqué mais aussi dans les filières. Je ne rentrerai pas dans les détails là-dessus, parce que ce n’est pas une chose que je maîtrise très bien, mais j’ai le sentiment qu’il y a vraiment un travail à faire – du coté aussi des moyens techniques ou des moyens pratiques, notamment via les technologies, les mécanismes de financement mais aussi des enjeux, par exemple, autour du foncier – voir Romainville : on a là un vrai sujet.
Alors une fois qu’on a nommé ce qui pourrait faire l’objet de communs, comment ça pourrait marcher ? Comment on pourrait imaginer que ça fonctionne ? En réalité, l’impression que j’ai, c’est qu’on a aujourd’hui tout un ensemble de dispositifs, d’initiatives qui peuvent contribuer à faire du médicament en commun. Ces initiatives, on en a nommé un certain nombre. On a parlé de l’hôpital, tout à l’heure, on a parlé des pharmacies d’hôpital, mais on peut, autour de ça, en agréger d’autres. Enfin on a un ensemble d’acteurs où chacun prend sa part : des labos, parce qu’effectivement il y a des labos qui ne veulent pas forcément rentrer dans le système financiarisé et qui luttent contre ça, on a des organisations soignantes, on a des organisations de patients, même si on peut discuter de la manière dont elles sont impliquées – et il y a probablement une diversité d’organisations de patients qui seront intéressantes à regarder ; il y a des entreprises, il y a des syndicats via les hôpitaux, il y a les labos de l’Open science, par exemple, Open insuline – on parlait de l’insuline tout à l’heure, c’est un exemple – , il y a InteropSanté – L’interopérabilité des systèmes d’information de santé – InteropSanté (interopsante.org) – , qui travaille sur une alternative au système, aux plateformes. Vous voyez, on a là, en fait, tout un ensemble d’acteurs qui, eux, peuvent prendre en charge la question du médicament bien commun. La question du médicament bien commun, elle ne se résout pas uniquement à l’intérieur de l’usine, elle se résout, en fait, dans cet ensemble-là. J’ai repris ici la citation de « il n’y a pas de commun sans communauté » ça veut dire il n’y a pas de commun sans engagement, sans faire communauté autour du sujet dont on est en train de parler, qui n’est pas seulement le médicament, mais qui est en fait la santé. Il y a, derrière chacun de ces opérateurs-là, un certain nombre d’enjeux. Chacun a sa singularité, son modèle qui peut être singulier, mais l’enjeu c’est de faire système ensemble et de faire réseau ou communauté. Je ne vais pas trop prendre de temps là-dessus mais, pour ça, il y a un certain nombre de choses qui se développent.
On a beaucoup travaillé sur la question du partenariat public-commun. Entendu : dès lors que l’on est sur une usine qui doit fabriquer des médicaments ou dès lors qu’on est sur la recherche, on a besoin de s’articuler ou d’articuler le public et le commun de telle manière que ça fonctionne. Non pas pour dégager simplement les bénéfices pour le privé et les coûts pour la communauté mais pour trouver des modalités d’articulation qui permettent de générer une économie qui va être orientée vers le commun. C’est une économie dont les surplus vont pouvoir être gérés par les communautés en question. Et puis je dirais, à l’autre bout du paysage, on a besoin que cet ensemble d’acteurs-là fassent réseau, fassent communauté. Et ça, on en parlera peut-être plus cet après-midi.
Le 2e point, qui est capital à mon avis, c’est que, pour rentrer dans une logique communaliste, on a à changer les infrastructures, on a à travailler, en fait, sur l’ensemble des infrastructures. Tout-à-l’heure, j’en nommais un certain nombre, mais je pense qu’on doit élargir cette question-là. Les infrastructures communes dont on a besoin vont toucher à la logistique sur les questions d’approvisionnement, distribution. Elles vont toucher à des enjeux techniques comme le foncier ou la technologie, le financement, la recherche. Mais elles vont aussi toucher à des infrastructures normatives, c’est-à-dire les réglementations sanitaires et les systèmes de protection sociale, ou à la manière dont on imagine le système de protection sociale. Vous avez tous, par exemple, beaucoup entendu parler de la sécurité sociale alimentaire. Aujourd’hui, ré-imaginer des systèmes qui inversent le rapport de forces autour de la question de la santé. Ça nécessite aussi d’imaginer un type de mécanisme dans lequel on n’est pas sur quelque chose qui va être simplement la recentralisation, la ré-étatisation à la manière de ce qu’on a fait à la sortie de la 2e guerre mondiale. Clairement, ce n’est pas ça qu’on est en train de chercher ensemble mais c’est quelque chose qui renouvelle, en fait, ce modèle-là, avec une participation et une réelle démocratie autour de la santé. Ca veut dire aussi qu’on doit penser ensemble ce que j’appellerais des infrastructures politiques, qui vont nous permettre de travailler à un récit commun qu’on veut partager autour de la santé.
Tout-à-l’heure, quelqu’un parlait d’éducation populaire. C’est exactement le problème que ça pose. Comment est-ce qu’on se donne et comment on donne à la société un récit de la santé et du médicament qui n’est pas celui qu’on a aujourd’hui, qui nous est transmis notamment par la publicité. Je trouve que c’est édifiant, les publicités qu’on entend aujourd’hui. On a aussi un tout un dispositif de plaidoyer à activer au niveau national, au niveau même local, parfois régional ; au niveau national et au niveau international, à différentes échelles au niveau international. Pour faire tout ça, et c’est là où je retrouve peut-être ma casquette de spécialiste des communs, on peut mobiliser toute une panoplie d’outils théoriques qui sont, je dirais, la « boîte à outils d’Elinor Ostrom » (Elinor Ostrom — Wikipédia (wikipedia.org),autour des principes de soutenabilité, autour du partage des droits et des responsabilités. Tout un travail s’est fait autour de la question des communautés, autour des distinctions entre communautés d’usage, communautés de préservation et communautés de contrôle, qui permettent de penser, en fait, des dispositifs de gouvernance en interne. Il s’agit donc de construire des cultures de la gouvernance en commun, qui soient ancrées ou qui permettent de constituer ces dispositifs. C’est presque l’esprit de ce qu’on veut dire par médicament en commun.
Et puis, bien sûr, il y a l’outillage qui se développe autour du partenariat public-commun, qui nous permet de regarder comment la valeur et les flux de valeurs peuvent être maîtrisés, utilisés, ou en tout cas maîtrisés par les communautés et pas seulement par les acteurs financiers, et ensuite redistribués et être générateurs d’une économie en commun. Ensuite, on a tout ce qui est de l’ordre des patterns ou des modèles qui ont été retravaillés.
Donc on est en train de penser aujourd’hui le médicament en commun. Bien sûr, on peut à partir de là plonger au cœur de l’usine, au cœur du réacteur, comme disait quelqu’un tout-à-l’heure. Pour regarder comment ça se fabrique et qu’est-ce qui doit être approprié pour que les médicaments soient fabriqués comme des communs. Mais ça ne se fera que si on est dans un périmètre ou dans un dans un paysage comme celui-là. Voilà, je vous remercie pour votre écoute.
***
La discussion
Marmar Kabir – Recherche clinique Sanofi – critique le schéma simplifié du processus de production de médicaments présenté. La vie du médicament ne s’arrête pas une fois mis sur le marché ; vient ensuite le suivi dans la vraie vie : quelle est son efficacité, sa tolérance, etc. L’IP fait un amalgame entre la commercialisation et la pharmacovigilance. Ce qui n’est pas exact.
Frédéric Sultan précise que le processus de production a été présenté de manière simplifiée pour définir de quoi on parle, quelles sont les choses qui font l’objet du commun. Le terme de communs appelle des sens très variés. Il est important de bien définir de quoi on parle pour construire une stratégie politique, avec des modalités d’organisation, des organisations sociales. Ce qu’on veut, c’est passer d’une économie à une autre.
Christophe Prudhomme rappelle que la particularité de la santé, c’est l’interdépendance. On ne peut pas être en bonne santé tout seul. Face au libéralisme, qui pousse à l’individualisme, il faut retrouver le commun, le sens du collectif. La santé, c’est beaucoup d’acteurs. Mais ceux qu’on doit mettre au centre pour définir les besoins, ce sont les patients. Les experts qui s’expriment à leur place ne sont pas tout-à-fait légitimes. Il faut s’interroger sur la liberté individuelle. Exemple : refuser de se vacciner peut nuire à la collectivité. C’est toute une politique à discuter.
Jean-Luc Maletras – consultant Thalès Geris – précise que, pour créer du commun, il faut arriver à converger. Sur le projet d’imagerie médicale (11 ans de travail), il a fallu convaincre les professionnels de la santé que les matériels qu’ils utilisaient n’étaient pas adaptés, qu’il fallait les penser en fonction de la pratique professionnelle. Tels quels, ils ne sont pas « démocratisables ». Tout ne peut pas être standardisé. Il a fallu parler avec tous les corps de métiers, et avec les patients, pour construire ce projet, en adaptant à chaque fois l’argumentation. Il faut construire un faisceau. Un outil très utile a été le site Web, un moyen de se faire connaître, d’être contacté, de faciliter les interactions.
Frédéric Sultan revient sur l’idée qu’on ne peut pas être en bonne santé tout seul. Pareillement, on ne peut pas produire un médicament bien commun tout seul, au milieu des autres, qui seraient produits par le système tel qu’il est. On a besoin de l’ensemble des interdépendances, ce qui rend la chose complexe. La difficulté est de savoir par quel bout commencer. Il faut commencer par tous les bouts et aussi constater qu’il y a déjà des bouts commencés. Ne pas chercher un modèle unique, qui serait celui d’une entreprise de production de médicaments en commun. Prendre en compte cette dimension, intégrer le déjà là, le prendre tel quel. L’ensemble des acteurs, à partir du moment où ils partagent les mêmes valeurs, ont un horizon politique commun, peuvent se mettre d’accord pour construire une communauté de santé en commun. On ne pourra pas faire un médicament bien commun tout seul.
Gaëlle Krikorian : C’est la logique de notre collectif « Produire des médicaments comme communs » ! On essaye d’agréger des compétences et des profils différents, et de s’acculturer les uns les autres, gens du médicament, gens du commun, pharmaciens, juristes, etc.
Il s’agit de réussir à penser quelque chose qui soit à la hauteur des enjeux (ce n’est pas si facile), qui puisse faire sens pour les différentes communautés d’acteurs.
Commentaire sur le suivi en vie réelle : dans notre travail, il y a l’échelle du site de production et celle du réseau du commun pharmaceutique (une communauté qui peut inclure du privé, à partir du moment où il accepte de se plier aux règles). Un des enjeux, au niveau du site, vrai aussi au niveau du réseau, est la restitution. On peut penser le réinvestissement d’une partie de ce qui a été généré dans un certain nombre d’actions et de services mutualisés entre les gens du réseau. Ce pourrait être de générer des infos sur les produits, qui soient neutres, permettre la collecte du retour sur l’utilisation de ces produits, pour informer sur ce que cela donne dans la vie réelle. Aspect sur lequel nous avons des problèmes, avec le contrôle par les multinationales de l’économie du médicament : soit on n’a pas accès aux infos (à cause du secret des affaires), soit on a affaire à des tas de pratiques de falsification, de dissimulation d’infos.
Ce sont des aspects qui n’intéressent pas directement la production, mais l’usage du médicament. Du coup, on discute sur : « C’est quoi un médicament, on veut faire quoi avec ? ». C’est une façon de le remettre à une certaine place au sein de la santé. Bien sûr que les médicaments peuvent être très utiles, mais beaucoup ne le sont pas, voire certains peuvent être dangereux. Le médicament est un élément de la santé, notre objectif c’est la santé, pas seulement avoir des produits et pouvoir les utiliser.
Cette démarche est longue et complexe mais on avance. Nous avons cette conversation entre les différentes catégories d’acteurs. Sur cette base, on peut construire quelque chose, ce qui veut dire quelque chose pour la plupart des gens, sur ce que veut dire le droit à la santé. Nous sommes dans un paradoxe : à la fois penser, avec le sens commun, qu’on a droit à des choses, que l’État est sensé faire des choses et, en même temps, cohabiter avec une réalité qui est de toute façon de moins en moins ça. Le plus gros de la population est un peu comme la grenouille en train de se faire cuire dans une casserole dont la température de l’eau monte graduellement – il n’y a pas de réaction massive. Je rejoins l’opinion émise, que par l’éducation populaire ou d’autres moyens, on a vraiment besoin que chacun, individuellement, en tant que patient potentiel, s’en mêle. Si on ne s’en mêle pas, on a beau avoir des alliés dans certaines institutions, qui font parfois le job super bien, ça ne va pas suffire.
Laurence Cohen : C’est plein de paradoxes. Les choses ne sont pas figées. Il faut mettre le pied dans la porte et, quand on le met, sachant qu’on est dans un système capitaliste, cela peut être dévoyé. Avec le bruit qu’a fait le rapport sénatorial, mais aussi les scandales qui ont eu lieu, la réaction des patients, il y a des choses qui font que le gouvernement se doit d’agir, mais c’est toujours avec une optique capitaliste.
Quand ils nous ont dit que les établissements pharmaceutiques, les hôpitaux, doivent avoir plus de moyens pour produire, qu’il faut donner plus de moyens aux préparations hospitalières ou aux préparations magistrales, cela va être dévoyé pour que le privé se débarrasse d’un certain nombre de médicaments, qu’il juge non rentables, et continue à faire des profits juteux. Est-ce que cette perversité du système doit nous laisser les bras ballants ? Je pense qu’il faut continuer à mettre le pied dans la porte pour essayer de généraliser et transformer les choses. Mais il faut donner des exemples qui fonctionnent, pour démontrer, à ceux qui opposent des arguments de rentabilité, que c’est possible. Nous avons intérêt à réfléchir à comment cela se passe dans d’autres pays : il y a des exemples de production publique, avec des histoires diverses, qui fonctionnent. C’est vrai au Brésil, en Égypte, en Suisse, aux États-Unis.
Il nous faut arriver à démontrer ces contradictions – Macron défend les IP, est pieds et poings liés avec Sanofi – pousser le gouvernement à dire qu’il y a des choses qui peuvent être différentes.
Aujourd’hui de plus en plus de médicaments sont impactés par les pénuries, cela touche les patients. Pour les patients, il faut de l’éducation populaire. Car les labos se servent aussi des patients. Exemple : quand un médicament est sur le point de voir le jour, les labos disent qu’il y a des lenteurs administratives, que c’est trop lent, qu’il faut une mise sur le marché précoce. C’est la porte ouverte à des profits extrêmement juteux. Les patients, qui attendent le traitement, vont aller dans le même sens, ils vont faire pression.
Il faut nous appuyer sur ces contradictions pour montrer qu’autre chose est possible, donner des exemples.
Marmar Kabir précise que les bases de données de la Sécurité sociale sont des bases de données exhaustives, c’est-à-dire qu’elles contiennent toutes les données de patients. Les labos utilisent ces bases de données, prétendument pour surveiller la tolérance, l’efficacité des médicaments dans la vraie vie. En réalité, ils ont beaucoup d’infos super-importantes sur les patients, y compris pour des utilisations commerciales. La condition, pour avoir accès à ces données, est d’avoir une question scientifique, par exemple : suivi de la prise en charge des angines en France.
Nous aussi, nous pourrions demander de pouvoir utiliser, en alternative, ces données (données personnelles des patients) pour suivre le médicament, savoir si l’efficacité prétendue au moment de la mise sur le marché est réelle en vraie vie. Cela peut nous aider.
C’est une question complexe. Il n’y a pas que les bases de la Sécurité sociale. Il y a aussi celles que les académiciens ou les universitaires créent à partir des données des patients. Exemple : vous faites un infarctus, vous allez à l’hôpital, vos données sont collectées dans une base de données, qui appartient à une société savante, qui peut vendre vos données à l’IP. Vos données sont vendues à l’IP ! Piste alternative à ce que disait précédemment Gaëlle.
Frédéric Sultan : Bien sûr qu’il faut mettre le pied dans la porte chaque fois que c’est possible. Notre point de vue est que tout le monde ne peut pas être partout en même temps. Du coup il faut s’articuler. Ces stratégies-là doivent se déployer. On doit peut-être élargir le cercle ici. C’est important de ne pas hiérarchiser ces questions. Oui, on a besoin de batailles politiques, on a besoin d’être présents sur ces sujets dans des arènes politiques, à différent endroits, à différentes échelles.
En même temps, on a besoin d’expérimenter, de développer des pratiques, qui nous permettent de faire la preuve (ce sera montré cet après-midi) qu’il y a des choses qui marchent, que l’on peut développer pour que ça fonctionne. Parce que sinon, on est toujours dans l’opposition, et on sait que cela peut être contre-productif. On a besoin de ces expérimentations au niveau de la production de médicaments, des mécanismes de la protection sociale, au niveau de l’hôpital, au niveau de la place des patients dans cet ensemble-là.
Tout cela n’est pas du tout concurrent, bien au contraire. Pour nous, l’enjeu est d’arriver à se positionner de façon harmonieuse. Bien entendu, chaque acteur peut prendre la place qu’il décide, qu’il est à même d’occuper dans cette lutte sociale. C’est une chose à prendre en considération.
Une des clés, quand j’affichais qu’il faut remplacer la recherche telle qu’elle fonctionne aujourd’hui, accaparée par le privé, alors qu’elle est largement financée par le public, par des mécanismes de recherche « open sciences », des mécanismes qui mettent en commun la science, la technologie, les données, l’ensemble des ressources, des matériaux, qui sont utilisés pour les médicaments, c’est de définir ensemble ce qu’on entend par là, concrètement, quelles sont les valeurs qu’on défend, et du coup de se mettre d’accord pour dire : « Ok, moi si je participe à la production de médicaments en commun, c’est parce qu’elle répond à ces critères-là ». Et ces critères, on les définit en entrant dans le détail. Ce n’est pas en ayant un grand schéma, en disant que c’est produit en commun, parce que ça répond à une économie coopérative, économie qui redistribue peu ou pas ses bénéfices. Pour moi, ça ne suffit pas. Il faut qu’on aligne un ensemble d’éléments qui nous permettent d’expliciter ce qu’on entend par commun, de voir comment on fait adhérer à ces mécanismes les acteurs qui sont dans la production ou dans la communauté concernée, et comment on fait que ce mécanisme-là fait récit commun, fait un nouveau récit de la santé, autrement qu’aujourd’hui avec les Big pharma.
***
2e table ronde
Quelles approches possibles pour rendre le médicament non-appropriable ?
Animée par Danielle Sanchez, membre du collectif MBC
Nous proposons de poursuivre cette démarche en entrant dans le vif du sujet, par l’exposé d’expériences concrètes, en France et dans le monde, mais aussi, de manière politique, d’une autre façon de penser l’articulation entre santé publique, recherche et production de médicaments, pour répondre aux besoins, pour s’extraire de la domination de l’industrie pharmaceutique.
Pour commencer, nous avons demandé une contribution à 4 intervenants, que je vais vous présenter :
- Gaëlle Krikorian, sociologue, autrice de plusieurs publications, dont ce livre récent « Des Big Pharma aux communs : petit vadémécum critique de l’économie des produits pharmaceutiques » (Lux Editeur, 2022), et Bernard Dubois, ancien salarié Sanofi et syndicaliste. Tous deux vont nous faire partager une expérience concrète pour produire autrement du médicament comme un commun
- Maurice Cassier, sociologue au CNRS, auteur du livre récemment paru : « Il y a des alternatives, une autre histoire des médicaments (19e au 21e) » (Seuil, 2023), qui va illustrer cet enjeu de l’appropriation sociale du médicament par 3 expériences alternatives dans le domaine de la R&D et de la production pharmaceutique
- Frédérick Stambach, médecin généraliste, coauteur avec Julien Vernaudon, praticien hospitalier, de plusieurs articles dont « Pour un Pôle socialisé du médicament » (LVSL, 6 octobre 2021) et « Pour un service public de santé territorial » (ResPublica, 29 mai, 6 et 13 juin 2022)
Bernard Dubois, membre du collectif MBC
Produire autrement du médicament comme un commun, cas concret
Ce matin les interventions de Fabien Mallet (coordinateur CGT Sanofi), Laurence Cohen (ex-Sénatrice PCF, rapporteuse d’un rapport au Sénat sur les ruptures de médicaments) et Christophe Prudhomme (médecin urgentiste et syndicaliste) ont témoigné des conséquences sociales et des effets des choix d’entreprise sur la santé publique (Cf. leurs interventions).
Le fonctionnement des grands laboratoires pharmaceutiques est dicté par les actionnaires (fonds de pension, Black Rock …) : il s’agit d’organiser l’entreprise comme un système de production d’argent. La stratégie est financière, il n’est pas question dans ce modèle de répondre aux besoins de santé des populations – ou alors de façon très subsidiaire.
Tous les chapitres du bilan sont analysés pour réduire les dépenses : achats, salaires, passifs sociaux, gestion des stocks en flux tendu, spéculation sur les effets de change, réduction de la recherche interne pour user de la recherche publique ou de start up, optimisation fiscale exacerbée… Ensemble de mesures scrutées par les organismes de notations, comme Standard & Poor’s et autres Moody’s, pour un accès aux meilleurs taux de crédit. Et pour veiller au grain, les grands cabinets comptables (Mc Kinsey) mettent en œuvre la partition.
On est loin de la libre entreprise, de la libre concurrence et des secrets d’entreprise, ce ne sont que des formules de politique néolibérale, l’essentiel étant le business.
Ce système d’entreprises mondialisées, nous en mesurons les effets, le chantage sur le prix et l’opacité exigée des négociations, sur l’emploi, l’augmentation du travail précaire, les conditions de travail, les fermetures de sites, les exonérations fiscales et de cotisations sociales, d’où altération des finances publiques et dégradation des systèmes de protection sociale : santé, retraite, indemnités chômage… Et tout cela produit des ruptures de stocks de médicaments et un accès aux soins rendu difficile, voire impossible.
A l’actif du bilan figure la propriété, on y trouve le brevet. Cela confère à l’entreprise un terrible pouvoir, celui de décider de sa commercialisation ou non et d’en négocier le prix.
Médicament Bien Commun (MBC), dans son manifeste, a dénoncé les effets délétères du brevet sur l’accès aux soins (cf. medicament-bien-commun.org).
Ce mode de fonctionnement d’entreprises transnationales se retrouve dans tous les secteurs d’activités : santé, énergie, transport, agroalimentaire, gestion de l’eau, des ordures ménagères etc. Les dommages « collatéraux » sur les choix de société doivent faire l’objet d’un débat politique.
Dans cette attente et, plus prosaïquement, parce que blessés, scandalisés par la fermeture de nos ateliers, nos labos et par les ruptures de médicaments, nous avons constitué un groupe de travail (ex-salariés de l’industrie pharmaceutique, sociologues, économistes, syndicalistes, groupes comme MBC et Capitalexit médocs…), dont l’ambition est de créer une unité de production de médicaments gérée dans le cadre de l’économie sociale et solidaire (ESS : SCIC, SCOP…). C’est-à-dire avec un mode de gouvernance piloté par les salariés, les banques de l’économie sociale, les mutuelles, les hôpitaux, les associations de malades, les universités et organismes de formation, etc. Nous avons travaillé deux pistes. Une à partir d’un terrain nu situé sur la commune de Romainville, en lien avec la Mairie, qui affiche publiquement une volonté de création d’une structure de l’ESS dans le secteur de la pharmacie, et l’autre à partir d’un site industriel existant mais à l’avenir incertain.
Nous avons travaillé sur les ruptures de médicaments, sur les molécules abandonnées, sur les montants d’investissements…
Au fil de nos réunions, un réseau actif s’est étoffé ; nous avons rencontré Gaëlle Krikorian et Frédéric Sultan, qui travaillaient eux aussi dans cette visée. Nous avons de fait renforcé nos capacités et méthodologie de travail, rencontré et échangé avec des chercheurs britanniques travaillant sur les publics/communs. Le 14 septembre, nous avons présenté nos travaux et perspectives à un auditoire élargi et réactif.
Aujourd’hui, nous réfléchissons à l’étape d’après, à savoir la mise en œuvre de la production de médicaments comme commun à partir d’un site industriel disponible tout en imaginant des interactivités en réseau avec des structures ayant les mêmes valeurs. Cela suppose de définir quel travail technique nous devons poursuivre (industriel, réglementaire, économique…), quelles actions mener pour obtenir l’assentiment d’une opinion publique scandalisée par l’état de notre service public de santé et par les ruptures chroniques croissantes de médicaments.
***
Gaëlle Krikorian, sociologue
Transformer l’économie des médicaments: produire des communs pharmaceutiques.
Un réseau de communs pharmaceutiques
***
Maurice Cassier, sociologue
Trois expériences d’appropriation sociale des médicaments
***
Frédérick Stambach, médecin généraliste
Le pôle socialisé du médicament, un projet politique global.
***
La discussion
Les 3 expériences décrites par Maurice Cassier (Brésil, Afrique du Sud, Etats-Unis), illustrent de manière éclairante les possibles. Elles montrent que l’on peut affronter, bousculer la toute-puissance des labos, en particulier sur la détention des secrets ou processus de fabrication, problème d’accessibilité, auquel se sont confrontés les hospices de Lyon, en pleine épidémie Covid, pour produire le curare si nécessaire aux services de réanimation.
La discussion a fait ressortir le souhait qu’il y ait une confrontation de contenu entre les projets de pôle public et de pôle socialisé, ne pas s’en tenir à l’énoncé de slogans, mais intégrer l’approche des communs. En s’accordant sur le fait que cette entité doit intégrer la recherche et la production, associer l’ensemble des acteurs selon les principes de la démocratie sanitaire.
Une participante précise qu’actuellement, avec les Big pharma, nous sommes confrontés à une gestion néolibérale essentiellement aux USA et en Europe. Si nous sommes dans une visée de coopération alternative, pourquoi ne pas penser, interroge-t-elle, ce pôle socialisé, dès sa conception, dans des relations avec des pays autres que ceux de l’occident (Cuba, Iran, pays sous embargo ou BRICS), qui, bien entendu, sont des pays de gouvernement totalitaire, mais où les problèmes de santé existent.
La proposition de service public territorial de santé a été jugée intéressante, en précisant la nécessité de faire la différence entre centre de santé (qui relève d’un service public) et maison de santé (qui relève d’une démarche libérale et dont on voit la multiplication aujourd’hui pour palier au déficit médical). De même pour les médecins et les usagers-patients, l’exercice salarial diffère de l’exercice libéral.
Un participant souligne qu’il y a des possibles qui, s’ils ne remettent pas en cause entièrement le système, sont, comme cela a été dit, « un pied dans la porte ». Mais pour que cela marche, comment assure-t-on l’articulation, entre travailler des projets et en même temps faire avancer les idées, donc comment travailler d’une façon élargie ? Nous avons besoin, précise-t-il, de réussir des choses petitement, pour démontrer que c’est faisable, et les faire grandir aux niveau national et international. Il ne faut pas opposer la visée et la mise en place de projets qui permettent de faire la démonstration du possible.
Les camarades de Sanofi expriment cette idée : ne pourrait-on pas se manifester devant les entreprises avec des collectifs existants (MBC, Notre santé en danger, …) pour capter l’intérêt des salariés de l’IP et créer des rassemblements. Ceci en partant des problèmes concrets, comme les pénuries de médicaments.
En ce qui concerne le secret des affaires, il est rappelé que l’État, au travers du dépôt des AMM, a toutes les « recettes » et conditions de fabrication, un dossier complet. Le blocage vient de la HAS (Haute autorité de santé), organisme d’État. Il s’agit pour nous d’être plus agressif sur la revendication d’accessibilité.
Un intervenant informe de l’existence d’une instance, le CIH (Conseil international d’harmonisation des exigences techniques pour l’enregistrement des médicaments à usage humain – ndlr) dont la mission est de parvenir à l’harmonisation des données et des règlements et de s’assurer ainsi de la sûreté, de la qualité et de l’efficacité des médicaments développés et enregistrés par les différents pays participants. Il évoque également l’existence de l’exception Bolar, qui permet, 5 ans avant la fin du brevet, face aux pénuries, de surseoir à son application. Pour cela, il faut anticiper les besoins.
A été mise en débat la vision dans laquelle s’inscrivent ces projets : vision franco-française ou vision européenne, voire mondiale, pour une coopération alternative ? Quels seraient les relations entre ce pôle socialisé et d’autres pays, notamment en dehors de l’occident ? Indépendamment des régimes politiques, il existe de forts potentiels de recherche dans d’autres pays…
En réponse à ces questions, il est suggéré qu’un pôle public, ou un pôle socialisé, ne pouvait pas être conçu sans s’inscrire dans une construction européenne, pour certains participants un pôle public européen. Plus généralement, le besoin de réfléchir à l’échelle régionale et continentale a été souligné comme nécessaire. Il est rappelé que la charte des Nations Unies est toujours juste mais peu utilisée. Le contenu de notre journée, avec les différentes interventions, montre l’intérêt d’articuler les expériences locales et internationales. Il s’agit bien d’un projet politique global. Nous remarquons que chaque expérience alternative repose sur une entité de production, ce qui confirme le bien-fondé de ce projet.
Pôle public, jusqu’où ? Y compris sur la fixation des prix des médicaments ? D’une manière plus générale, ces projets de pôle public et pôle socialisé doivent prendre en compte l’expérience des 40 dernières années avec les dénationalisations dans le secteur pharmaceutique, sans résistance majeure.
***
En guise de clôture (provisoire !)
Francis Sitel, membre du collectif MBC
Bien que très honoré de la demande qui m’a été faite d’intervenir en cette fin du colloque, j’avoue me sentir privé de toute légitimité pour le faire. En effet, à la différence des oratrices et orateurs que nous avons entendus, toutes et tous fort informés et savants, je ne peux me revendiquer d’aucune compétence dans les sujets qui viennent d’être débattus.
Je n’ai aucune connaissance médicale, ni pharmaceutique.
Disons que je peux parler à titre de patient. Même pas au titre d’une association de patients, finalement c’est peut-être mieux, ayant entendu Christophe Prudhomme dire qu’en la matière il convenait d’y regarder de près. Donc juste comme titulaire d’une carte Vitale.
En tant que patient, j’ai partagé des illusions.
Illusion que le médicament est certes un objet complexe, mais en permanence disponible (au moins ici, on sait que ce n’est pas le cas partout). Bref, un sentiment de sécurité : le médicament est disponible quand on en a besoin, pour une anesthésie, des soins, des remèdes à la douleur…Il doit alors être fourni en urgence. Et si tel n’est pas le cas, du fait d’une pandémie, parce qu’il y a pénurie…, la sécurité cède à la panique.
Autre illusion : la confiance en la puissance publique, celle de l’État protecteur, qui assure cette disponibilité. Bien sûr, on sait qu’il y a des limites, celles qu’impose le développement de la science. Mais il faut parier sur les progrès de celle-ci. Les laboratoires y travaillent, ce qui leur vaut, à bon droit, crédits et investissements, et donc de justes retours… sur investissements.
Ces illusions, vous les avez fait voler en éclats.
Vous m’avez fait comprendre que ça ne fonctionne pas comme cela.
Le médicament est dans la main du Capital. Un capital qui n’est pas un simple parasite, comme la notion de « finance » peut le faire croire, mais une puissance qui opère une vampirisation de la santé. Cette « spoliation de la santé » qui conduit à sacrifier la recherche, et à abandonner certaines productions.
Du coup, le sentiment de sécurité cette fois laisse place à l’inquiétude.
Mais vous m’avez aussi convaincu qu’on peut ne pas céder à la désespérance. Car, comme l’a dit Thierry, il y a des « possibles ».
Et donc qu’il faut se mettre au travail.
D’abord éclairer la société. Fabien l’a expliqué, la société et les patients ne perçoivent pas ce qu’est le système de santé, n’ont pas les moyens de le connaître. Il a évoqué une nécessaire « éducation populaire » en la matière. Oui, faire tomber les murs de ce système, briser les « silos » plusieurs fois évoqués : les connaissances de celles et ceux qui sont dans ce système sont à faire partager à l’extérieur.
Et aussi construire le « sujet du commun », pour reprendre la formule de Frédéric Sultan.
Autour d’exigences dont on a repéré quelques-unes. Par exemple cette question de l’insuline plusieurs fois évoquée (qui existe sans la chaîne du froid, dont les prix peuvent être diminués de moitié…). On a aussi évoqué l’abandon du paiement à l’acte médical, dont on parle aussi dans d’autres espaces. Ou encore le coût financier des pénuries de médicaments, dont Laurence Cohen nous a dit que la Sécurité sociale se disait dans l’incapacité de l’évaluer.
Il est intéressant de noter que pénurie ne veut pas dire rareté, mais bien spoliation, du fait de la politique prédatrice de Big pharma et d’une gouvernance déresponsabilisée.
On a souligné l’écart entre le discours gouvernemental (« il faut que ça change », il y a nécessité de « relocaliser », de « réindustrialiser »…) et la réalité. Entre l’un et l’autre, le maillon manquant est celui de la mobilisation.
Mobilisation pour le droit à la santé, pour un « commun pharmaceutique », pour l’objectif du pôle public, socialisé, de la recherche et production du médicament.
Un problème a été finalement soulevé, celui de la dimension internationale. La logique n’est pas celle d’un repli national, mais celle du déploiement d’une dynamique internationale. Dès lors qu’on brise avec la logique du profit et de la guerre commerciale, pour chevaucher celle des réponses aux besoins sociaux, qui pour l’humanité sont immenses, on n’est plus dans la compétition mais dans la coopération… Cette brisure, elle s’applique à différentes échelles, du plus proche au plus distant, du local au mondial, de l’individu à l’humanité.
Beaucoup de travail devant nous !
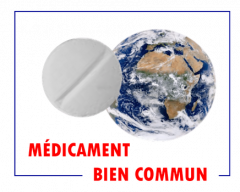
MERCI.
VOUS ÊTES FORMIDABLES.!
Vous êtes un espoir et nous sommes probablement nombreux prêts à participer à cette « guerre » que les populations doivent gagner.