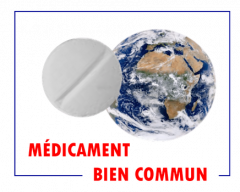La France s’est révélée incapable de dépister massivement les malades du Covid-19, révélant la dépendance de la santé publique vis-à-vis des laboratoires privés.
par Quentin Ravelli (*)
Article publié dans le Monde diplomatique Avril 2020
Les crises économiques sont aussi sélectives que les épidémies : à la mi-mars, alors que les Bourses s’effondraient, l’action du laboratoire pharmaceutique Gilead grimpait de 20 % après l’annonce des essais cliniques du remdesivir contre le Covid-19. Celle d’Inovio Pharmaceuticals gonflait de 200 %, à la suite de l’annonce d’un vaccin expérimental, INO-4800. Celle d’Alpha Pro Tech, fabricant de masques de protection, bondissait de 232 %. Quant à l’action de Co-Diagnostics, elle flambait de plus de 1 370 % grâce à son kit de diagnostic moléculaire du coronavirus du syndrome respiratoire aigu sévère 2 (SRAS- CoV-2), responsable de la pandémie de Covid-19.
Comment expliquer qu’au cœur de la tourmente il soit ainsi possible de s’enrichir alors même qu’il manque des masques de protection, y compris pour les médecins et les personnels soignants, et que les tests de dépistage restent inaccessibles au plus grand nombre après trois mois d’épidémie ? Pourquoi ces tests sont-ils au cœur du débat mondial, de la Corée du Sud aux États-Unis, en passant par l’Allemagne, l’Australie et la Lombardie, mais restent soigneusement évités en France, où le directeur général de la santé, M. Jérôme Salomon, n’envisage leur usage massif qu’« à la sortie du confinement » ? Contrairement aux annonces gouvernementales, loin d’être une guerre contre un virus dont la seule arme serait la quarantaine, la bataille concerne notre propre organisation économique et sociale. C’est une crise de notre politique de santé, de recherche et de production, où l’industrie pharmaceutique joue une place centrale, mais soigneusement maintenue à distance du débat public.
Depuis quelques semaines, la pandémie du coronavirus révèle les failles d’un modèle social fondé sur l’idée de la rentabilité économique de la santé, justifiant des baisses budgétaires toujours plus contraignantes pour le personnel et les patients. En France, avec la saturation des salles de réanimation et des services des urgences, déjà en lutte depuis des mois dans le collectif Inter-Urgences pour demander plus de moyens, les soignants doivent faire des choix dramatiques entre les soins vitaux, dont la liste se réduit, et ceux qu’on sacrifie, toujours plus nombreux. Dans certains cas, comme en Alsace, cela revient déjà à se demander qui il faut maintenir en vie et qui on peut laisser mourir. Mais comment expliquer que, le 22 mars dernier, on comptait déjà 271 morts dans le Grand-Est alors qu’à deux pas de là, de l’autre côté du Rhin, dans le Bade-Wurtemberg, où la population est deux fois plus nombreuse et l’épidémie plus précoce, il y en avait seulement 23, soit plus de dix fois moins ?
L’une des réponses à cette question se trouve dans la place très politique que joue l’industrie pharmaceutique dans nos systèmes de santé. C’est elle qui produit les outils permettant de dépister le virus, de nous vacciner contre lui ou de le traiter. Si la France en manque cruellement, les kits de dépistage — dont la technologie par réaction de polymérase en chaîne (PCR) identifie le virus en amplifiant son ADN — sont pourtant simples à fabriquer. De nombreuses entreprises se sont lancées sur ce marché colossal, qui vient de surgir comme un geyser : Abbott, Qiagen, Quest Diagnostics, Thermo Fisher, Roche, BioMérieux… La technique est peu coûteuse — de l’ordre de 12 euros pour un kit vendu 112 euros en France, dont 54 euros à la charge des patients. Mais elle peut faire l’objet d’accords tarifaires prohibitifs dans un contexte de monopolisation du marché entre quelques grandes entreprises, comme Abbott ou Roche, qui vendent aux laboratoires de quartier des plates-formes technologiques hors de prix (1).
Orienter les recherches à partir d’une vision générale de la science, de la médecine, de l’écologie
Même avec ces limitations économiques, comment expliquer que la France ait effectué, au 20 mars, près de deux fois moins de tests par million d’habitants que l’Iran ou l’Autriche ? Qu’avec moins de 40 000 tests pratiqués à cette date elle soit loin derrière les 316 644 de la Corée du Sud, les 167 000 de l’Allemagne, les 143 619 de la Russie ou les 113 615 de l’Australie (2) ? En Corée du Sud, on peut être testé dans sa voiture ou dans des cabines vitrées où les praticiens font les prélèvements avec des gants en caoutchouc. Le dépistage systématique, accompagné d’un suivi de chaque personne contaminée, permet de briser les chaînes de transmission en isolant ceux qui sont malades et pas les autres. En conséquence, les mesures de confinement sont bien moins restrictives, le taux de mortalité des patients positifs est plus bas et, surtout, le nombre de morts bien moins élevé qu’en France, malgré la proximité du foyer infectieux chinois.
Si le dépistage est bien l’un des angles morts de la lutte française contre l’épidémie, il y a aussi un autre angle mort à l’intérieur de celui-ci : la pénurie des réactifs, ces composants chimiques essentiels au dépistage, qui attestent la présence du virus. De ces molécules on ne sait presque rien : ni d’où elles viennent, ni à quoi elles servent, ni combien elles coûtent vraiment. Pourquoi ne pas lever tout secret industriel, tout secret commercial et tout brevet sur la composition de ces réactifs si précieux pour la santé de milliards d’êtres humains, et faire connaître au public l’origine de leurs matières premières, comme les voies de leur fabrication ?
Outre le dépistage, la deuxième arme essentielle dans cette guerre est celle du médicament qui permettrait de guérir du Covid-19. Selon une annonce du gouvernement chinois, le favipiravir — le principe actif de l’antigrippal Avigan, produit par l’entreprise japonaise Fujifilm — donnerait de « très bons résultats » contre le virus en réduisant la durée de guérison. Un autre candidat, le Kevzara, un anticorps monoclonal inhibiteur des récepteurs de l’interleukine 6, indiqué contre la polyarthrite rhumatoïde, évalué en partenariat entre Sanofi et Regeneron, pourrait réduire la réaction pulmonaire inflammatoire du virus chez les patients sévèrement touchés par le Covid-19. Ces reconversions de molécules dans l’urgence témoignent d’une absence de planification des problèmes de santé et d’une fébrilité opportuniste en lieu et place d’une politique industrielle.
On pourrait se dire qu’il est par définition impossible de prédire une pandémie et que la recherche est condamnée à être prise au dépourvu. Cet argument ne tient pas : à défaut de prédire, on peut prévoir, orienter les recherches à partir d’une vision générale de la science, de la médecine, de l’écologie. De telles recherches ne peuvent pas se conduire à court terme, avec des impératifs de profit. Elles se mènent au long cours en fonction des besoins réels de la population. Or ces besoins ne correspondent structurellement pas aux marchés solvables : 85 % des médicaments sont consommés dans des pays qui regroupent 17 % de la population mondiale, et il y a plus de recherche de médicaments pour la dépression et l’obésité que pour les maladies infectieuses, qui sont l’une des toutes premières causes de mortalité dans le monde.
Quand survient la crise, ce décalage conduit à des situations aberrantes, dont la troisième arme — les vaccins — fourmille déjà d’illustrations. M. Donald Trump propose par exemple d’acheter à l’entreprise allemande CureVac le brevet de son vaccin contre le coronavirus pour l’utiliser « uniquement aux États-Unis », suscitant un refus catégorique de Mme Angela Merkel et une subvention-éclair de 80 millions d’euros de l’Union européenne. Cette précipitation diplomatique, non dénuée d’arrière-pensées électorales, traduit une réalité industrielle : comme la recherche se fait essentiellement par incitations financières et par brevets, les grandes entreprises pharmaceutiques réduisent leurs investissements dans les domaines médicaux essentiels, dont font partie les infections, qu’elles soient bactériennes ou virales. Mais, là encore, le rythme réel des recherches n’est pas adapté : l’entreprise Moderna Therapeutics, considérée comme la première à développer un vaccin, ne pourra pas le mettre sur le marché avant plusieurs mois — ce qui n’a pas empêché le cours de ses actions de faire un bond après l’annonce de son projet.
Savoir qui est réellement infecté éviterait l’incertitude, l’assaut des urgences et les mesures excessives. Isolement et confinement seraient proportionnés à la progression réelle du virus et non aux calculs de risques hypothétiques, induisant des coups de barre gouvernementaux. Le dépistage massif serait aussi une mesure simple de démocratie médicale. Mais comme cela suppose de la prévoyance, voire un contrôle des industries par l’État, elle est difficile à mettre en place dans un système capitaliste fondé sur le profit. On peut même parler d’une discrimination de classe : si, à la mi-mars, dix-huit députés et deux ministres ont été dépistés et s’avouent en bonne santé (sauf l’un d’eux), alors qu’on réserve le dépistage aux cas les plus graves pour le reste de la population, c’est bien qu’il existe des inégalités sociales de santé. Le dépistage est devenu un privilège de classe.
Ces impasses de la recherche privée ne sont pas compensées par la recherche publique. Les coupes budgétaires tombent souvent comme des guillotines sur des projets patiemment développés. Le 4 mars dernier, le chercheur Bruno Canard, spécialiste en réplication des « virus à ARN » — un virus dont le matériel génétique est constitué d’acide ribonucléique — comme le coronavirus, expliquait dans une tribune : « Dès 2006, l’intérêt des politiques pour le SRAS-CoV avait disparu ; on ignorait s’il allait revenir. L’Europe s’est désengagée de ces grands projets d’anticipation au nom de la satisfaction du contribuable. Désormais, quand un virus émerge, on demande aux chercheurs de se mobiliser en urgence et de trouver une solution pour le lendemain. Avec des collègues belges et hollandais, nous avions envoyé il y a cinq ans deux lettres d’intention à la Commission européenne pour dire qu’il fallait anticiper (3). » Ce chercheur a beau clamer que « la science fondamentale est notre meilleure assurance contre les épidémies (4) », il ne peut que constater que certaines branches de la virologie et de la bactériologie restent des parents pauvres de la recherche — qu’il s’agisse de recherche pharmaceutique appliquée ou de microbiologie fondamentale. L’« appel Flash » de l’Agence nationale de la recherche, doté de 3 millions d’euros, semble dérisoire, quand il arrive après des années de désinvestissement et d’autres épidémies similaires. Après le coronavirus responsable du syndrome respiratoire du Moyen-Orient (MERS) en 2015, et le SRAS de 2003, surgi en Chine (8 096 personnes infectées dans une trentaine de pays, causant 774 décès), la Corée du Sud avait finalement réorienté ses politiques de santé publique et jeté les bases de son action actuelle. Pour que les gouvernements aient de la mémoire, il faut manifestement que les traumatismes soient forts et répétés. Et, même dans ce cas, c’est souvent l’amnésie qui l’emporte.
C’est toute cette politique de fond que l’État cherche à faire oublier, en soulignant subitement l’importance de la santé publique après l’avoir soigneusement minée pendant des années. M. Emmanuel Macron, le champion toutes catégories de la privatisation, a pu dire sans rougir, devant près de 22 millions de téléspectateurs, jeudi 12 mars : « ce que révèle cette pandémie, c’est qu’il existe des biens et des services qui doivent être placés en dehors des lois du marché ». La porte-parole du gouvernement Sibeth Ndiaye, de son côté, s’est mise à souhaiter que l’État soutienne les essais cliniques, pourtant réalisés depuis des décennies par les laboratoires privés. L’État français semble s’être mis, bien tard, à écouter le président de la Lombardie, épicentre de l’épidémie en Europe : « Ou bien on cache les problèmes sous le tapis, ou bien on enlève le tapis et on lave par terre ». La prochaine étape sera sans doute un virage à cent quatre-vingts degrés : l’apologie du diagnostic par Jérôme Salomon, après avoir méprisé tous les avertissements, y compris de l’OMS — « testez, testez, testez », disait Tedros Adhanom Ghreyesus. Autant de façons de reconnaître, le dos au mur, que la recherche de médicaments, et la santé en général, sont des enjeux qui ne devraient pas rester dans les mains du privé. Ils oublieront sans doute ces belles paroles dès la levée du confinement. En s’accumulant à nouveau, l’amnésie politique préparera les prochaines crises de santé publique.
Quentin Ravelli
(*) Chargé de recherche au Centre national de la recherche scientifique (CNRS). Auteur de La stratégie de la bactérie. Une enquête au cœur de l’industrie pharmaceutique, Seuil, Paris, 2015. Version longue de l’article paru dans l’édition imprimée.
(1) Communiqué de presse, Observatoire de la transparence dans les politiques du médicament, 18 mars 2020.
(2) Esteban Ortiz-Espina et Joe Hasell, « How many tests for Covid-19 are being performed around the world ? », Our World in Data, 20 mars 2020.
(3) Bruno Canard, « Coronavirus : la science ne marche pas dans l’urgence ! », Université ouverte, 4 mars 2020.
(4) Bruno Canard, « La science fondamentale est notre meilleure assurance contre les épidémies », CNRS Le journal, 13 mars 2020.