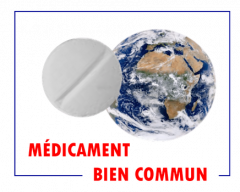Danielle Sanchez *
Certains politologues contestent que l’on puisse penser « le monde d’après » et invitent à être exclusivement « dans la vie avec » … Or pour sortir du désastre sanitaire, économique et social, il faut non seulement penser mais aussi agir maintenant pour changer les logiques qui nous ont conduits à cette situation. Qui a pu freiner la catastrophe la plus totale et sous quelles conditions ? La mobilisation des soignants d’un système de santé publique dont l’hôpital est le cœur, les compétences de la recherche, en particulier de la recherche publique, bien que prise au dépourvu par des années de diète budgétaire, la prise en charge par la Sécurité Sociale (700 000 tests de dépistage vont être pris en charge à 100%), la mise au rencart temporairement, c’est à craindre, de tous les critères des politiques d’austérité (dont le sacro-saint seuil du déficit public à 3% du PIB).
Les coupes budgétaires des gouvernements successifs, depuis 10 ans, ont dépouillé l’hôpital public de près de 12 milliards d’euros, donc des moyens pour faire face à l’épidémie. L’ONDAM[1] créé en 1996 par le gouvernement Juppé, indicateur fixé chaque année par la loi de Financement de la Sécurité Sociale (LFSS), et la régulation du financement des hôpitaux par la tarification à l’activité T2A, ont transformé l’hôpital en entreprise de soins, devant répondre aux critères de la rentabilité. Il faudra bien faire le bilan de ces décisions politiques désastreuses. Il faut aussi savoir reconnaître que si nous en sommes là, c’est parce que notre vigilance et notre mobilisation citoyenne, malgré les appels réitérés des soignants, a baissé la garde ! Raison de plus pour mieux réfléchir… Ne pas reprendre les mêmes orientations, une fois la crise sanitaire passée, n’est pas certain (1) Hôpital public: la note explosive de la Caisse des dépôts [2]. Il n’y a pas de fatalité dans l’impossibilité d’inverser ces orientations.
Pour la reprise économique, gouvernants et directions des entreprises ne veulent pas, au fond, de salariés-citoyens qui, même dans une situation anxiogène, questionnent le sens de leur travail, les objectifs et les conditions de réalisation de leurs activités, au regard de leur santé et de celle de la collectivité, des besoins réels et de la préservation des ressources naturelles. Méfions-nous de l’arrière-pensée du Président dans cette formule : « quoi qu’il en coûte ». On gèle le système économique, en se gardant de profiter de cette suspension pour le modifier. Une fois « décongelée », l’économie marchande redonnera le pire d’elle-même : productivisme et consumérisme, pour rétablir la rentabilité du capital. Comme le souligne Jean-Marie Harribey [3]: « la dynamique du capitalisme est contradictoire avec une responsabilité sociale et écologique ».
Pour quelle croissance ?
Pour mieux museler la réflexion, la parole médiatique et gouvernementale accentue le poids de la dette, que les français devront rembourser par leur travail ! « La France va sortir de ce choc avec une dette publique accrue d’au moins 15 points du PIB », prévient le gouverneur de la banque de France. La croissance a reculé de 5,8% au 1ertrimestre 2020. Ceci est un fait non contestable mais de quelle croissance s’agit-il ? Plus inquiétant est l’avenir des 11 millions de salariés actuellement en chômage partiel, de la hausse fulgurante du chômage dès mars (+177 500 selon la Dares. La dernière fois que l’on avait enregistré une telle hausse était en Avril 2009 : +86 300). Selon le BIT (Bureau international du travail), la réduction des heures travaillées dans le monde (-6,7% au 2ième trimestre 2020) représente une perte équivalant à 195 millions d’emplois à temps plein (2). Dans ce contexte, comment peuvent-ils marteler cette absurdité « Il faudra travailler plus, en augmentant le temps de travail ! » Nous renvoyons au débat économique relatif à la dette (3). Mais notons que même Alain Minc[4] défend désormais l’idée d’une « dette à perpétuité », que l’État ne rembourserait finalement jamais.
Nous serions dans une situation équivalente à celle du lendemain de la Libération en 1945. La comparaison n’est pas mauvaise, car c’est effectivement dans un pays ruiné qu’a été conçu le système de protection sociale le plus révolutionnaire du 20ième siècle. Celui que les américains nous envient, et qu’ils n’ont pas encore réussi à imposer (« Les États Unis, les sacrifiés de la santé » documentaire de Marie Agnès Suquet et Gary Grabli). Le système de santé de cette 1ièrepuissance mondiale coûte l’équivalent du PIB de la France. Mais le niveau d’espérance de vie en bonne santé est le plus mauvais des pays développés. Donc revenir à l’esprit qui a présidé à la création de la Sécurité sociale ne relève pas de la nostalgie du passé mais d’une visée d’avenir.
Changer de paradigme
Santé et économie peuvent ne pas s’opposer. Cela implique de changer radicalement de paradigme. Or il est des comparaisons auxquelles il ne faut pas négliger de s’attarder. Le gouvernement décide de débloquer 100 milliards d’aides publiques et fait jouer tous les dispositifs de solidarité sociale, qu’il a lui-même attaqués par ses réformes récentes. Puisqu’il est question de prioriser la santé et d’accélérer les recherches pour les traitements et les vaccins, il faut mettre en rapport ce chiffre (et celui de la dette) avec les bénéfices des laboratoires pharmaceutiques. L’Observatoire des multinationales.org fournit les éléments dans ses dossiers sur les Big pharma. « Les fabricants de médicaments figurent désormais parmi les plus grosses multinationales au monde, aux côtés des firmes pétrolières ou automobiles. Elles sont aussi les plus lucratives pour les marchés financiers …. Entre 1999 et 2017, les 11 plus gros laboratoires ont engrangé 1019 Milliards d’euros de bénéfices. De quoi investir massivement pour trouver des remèdes aux maladies qui sévissent partout dans le monde ? Non. Ils en ont directement redistribué 925 milliards à leurs actionnaires sous forme de dividendes et de rachats d’actions, soit 90,8%. »
Plus proche de nous, l’exemple de Sanofi France, dont le PDG vient de confirmer le versement de 4 milliards de dividendes à ses actionnaires, un record depuis la création du groupe, sur un exercice 2019 en hausse de 9,8%. Les résultats du 1er trimestre 2020 ont été dopés par les ventes de Doliprane et d’antibiotiques, faisant grimper le chiffre d’affaires de 8,9 milliards d’euros, en hausse de 6,9%. Ce qui fait dire à Thierry Bodin[5] qu’un renversement de philosophie s’impose : « Sanofi devrait s’engager à ne pas réaliser de bénéfices sur cette crise et mettre en accès libre les brevets pour trouver un traitement. Cette crise sanitaire repose plus que jamais la question de l’appropriation sociale des industries pharmaceutiques ». D’autant que le secteur pharmaceutique a sa propre « garantie publique » : la prise en charge des dépenses de santé par l’assurance maladie et le financement public de la recherche. C’est en grande partie grâce à cette garantie publique que ces laboratoires sont devenus ce qu’ils sont.
Les labos pharmaceutiques se préoccupent-ils de leur utilité sociale ?
Ruptures d’approvisionnement de médicaments essentiels, des pans entiers de recherche de santé publique délaissés, des prix exorbitants pour les médicaments dits « innovants », des restructurations en continu avec des milliers de suppressions d’emplois dans les équipes de recherche-développement comme chez Sanofi. A l’évidence, non. Si, comme citoyens, nous nous rassemblons pour dire : « Plus jamais ça, nous ne voulons pas revenir au monde d’avant ! », alors donnons à ce mot d’ordre les objectifs concrets qui imposent les obligations de responsabilité sociale. Peut-on continuer de penser de manière fataliste : « C’est une société capitaliste, un système capitaliste, des règles capitalistes ! ». Les brevets sur les médicaments, propriété intellectuelle et monopole de commercialisation, sont justifiés selon cette logique, comme un échange « donnant-donnant » avec la société, parce que ces labos prétendent avoir pris en charge la recherche et le développement.
La crise sanitaire remet au premier plan la priorité qui doit être accordée aux moyens d’existence : santé, alimentation, logement, environnement, culture. L’ampleur du recours indispensable à l’argent public offre une occasion unique : conditionner les soutiens et les investissements à leur compatibilité avec la transition écologique et une politique de santé publique souveraine. Empêcher que la logique interne au capitalisme reprenne le dessus. Plusieurs voix se sont exprimées en ce sens (4)(5)(6). La conscience citoyenne s’est aiguisée et peut être plus agissante. Pour Frédéric Pierru et le Pr André Grimaldi (7), revenir à l’esprit qui présida à la création de la Sécurité sociale, c’est défendre « une orientation traitant la santé comme « un commun » échappant à la logique du profit, et ne devant être ni étatisé ni privatisé, … revenir à l’esprit des « jours heureux » qui présida à la création de la Sécurité sociale et à la grande réforme hospitalière de 1958, celle qui fit entrer l’hôpital dans la modernité biomédicale avec la création des centres hospitaliers universitaires (CHU) où s’articulent soin, recherche et formation ».
La revendication des communs
La revendication des « communs » se développe face au renforcement de la propriété intellectuelle (PI), par les accords de libre-échange ADPIC à la création de l’OMC en 1994, consacrant l’exclusivité de monopole des brevets et leur légitimation mondiale. La justification n’est pas celle de préserver l’innovation et son concepteur. Le brevet est un outil de concurrence et de réservation des marchés. Pour les médicaments, les décennies précédentes ont largement démontré que les brevets se multiplient au détriment du droit universel à la santé. La pandémie Covid_19 met dramatiquement à nu le danger de laisser le contrôle des ressources stratégiques, comme « la connaissance » aux seules entreprises, qui s’en servent pour se livrer une concurrence destructrice. Nous devons nous insurger contre le gâchis qui se profile dans les recherches de traitements et vaccins (8). Les signataires du Manifeste pour une appropriation sociale du médicament (9) postulent que le médicament doit être un bien commun, comme principe d’une santé publique et environnementale à l’échelle planétaire. Ce manifeste revendique la suppression de la notion de propriété privée donc du monopole des droits de PI sur les médicaments attribués par les brevets d’invention.
Il ne s’agit pas seulement d’affirmer la valeur universelle d’un droit d’accès à la santé, en restant sur des principes moraux. En ce sens, postuler que le médicament devienne un « bien commun », rejoint la définition du « commun » qui structure l’essai de Pierre Dardot et Christian Laval [6] (10). Le commun est un principe et une construction politique, qui ne contournent pas les enjeux de propriété et de pouvoirs… « Dire que le commun, comme son étymologie l’indique, est d’emblée politique signifie qu’il oblige à concevoir une nouvelle institution des pouvoirs dans la société…Il donne à entendre qu’il n’est de monde humain souhaitable que celui qui est fondé explicitement et consciemment sur l’agir commun, source des droits et des obligations… ». Une des premières conditions est celle de dépasser la visée réductrice de l’entreprise néolibérale qui fait de la concurrence une cause à laquelle le salarié doit s’identifier. On ne peut « démarchandiser » le médicament si le travail qui le conçoit et le produit est aliéné à cet objectif. Le travail ne trouve sa véritable créativité et son efficacité qu’au travers du rapport collectif qui lui donne sens.
Libérer le travail
Le combat contre la pandémie Covid-19 a remis au-devant de la scène l’utilité sociale, même vitale, des métiers de la santé et de la recherche. Les hospitaliers ont pris les rênes. Dans leur coactivité et la coopération de toutes les catégories et fonctions, elles, ils, ont mis en place une auto-organisation en faisant sauter les contraintes bureaucratiques. Depuis de nombreuses années, les salariés de Sanofi, également d’autres entreprises de la filière pharmaceutique ou sous-traitants, défendent dans leurs luttes, l’intérêt général de la santé pour tous (11). Tout ce qui contribue à dégager le travail des contraintes aliénantes qui le réduisent à un moyen d’accumulation du capital, va dans le sens du commun. Dans ce combat, nous contestons que les « titres des sociétés » détenus par les actionnaires soient assimilés à l’entreprise. Entreprise qui, en droit, n’existe pas, le droit ne reconnaissant que la société de capitaux. Il faudrait donner à l’entreprise l’existence institutionnelle de communauté de travail, qu’elle est dans les faits sans être reconnue comme telle.
Si la logique du « commun » vise à s’extraire de la domination privée capitalistique, elle n’est pas pour être confisquée par l’État. Que ce soit le scandale du non renouvellement des stocks de masques ou de la pénurie endémique de médicaments, de la délocalisation des productions de principes actifs à l’étranger (la France est dépendante à 80%), les chaînes de décisions et de pouvoirs échappent à la société. L’État est devenu captif du pouvoir des Big Pharma. Il est urgent de dégager la santé publique de l’autocratie de ces géants de la finance. L’exigence de transparence est forte dans la société. Gare au gouvernement qui prendra la responsabilité de ne pas engager la France dans la reconquête de son indépendance sanitaire.
Et Sanofi ?
Sanofi (70 usines dans le monde, 40 en Europe, 18 sites en France) a une grande responsabilité dans cette situation. Son représentant en France se permet de déclarer [7]: « Les délocalisations sont une recette d’hier. La santé relève de la souveraineté nationale. Produire en France et en Europe est un atout majeur », certain que Sanofi, au profit de la pandémie, va pouvoir redorer son blason. L’idée qu’il soumet aux pouvoirs publics est de faire du lieu de production d’un médicament, un critère d’appréciation pour son prix de vente, la prime allant évidemment au « made in France » ou « made in Europe ». Et ajoute-t-il : « Bien sûr qu’il faut donner un bonus aux acteurs qui jouent la carte nationale. S’il n’y a pas de carotte, cela ne marchera pas. C’est comme ça. Et de plus en plus de personnes le comprennent désormais, depuis l’arrivée de ce fichu virus. » Indécence de la part du groupe qui a boosté ses ventes de Doliprane et de Paracétamol avec le Covid-19. Inacceptable chantage !
Regagner l’indépendance sanitaire, avoir une vraie politique de santé publique, dépendent plus de la mobilisation de la société que des actes attendus du gouvernement Macron-Philippe. Avancer vers le « médicament bien commun », vers une appropriation sociale de cette chaîne de la recherche à la production et à la distribution, ne peut se décréter d’en haut. C’est un processus de mobilisation des forces diverses de la société, sur tous les domaines concernés. De ce point de vue, les exemples de FAMAR et LUXFER sont instructifs. Les Salariés de FAMAR Lyon (entreprise sous-traitante des grands labos), présentent une alternative industrielle à la fermeture du site pour répondre à l’urgence sanitaire. Ils exigent la nationalisation. Le portefeuille de cette société compte, parmi sa soixantaine de produits, 12 médicaments d’intérêt thérapeutique majeur (MITM) qui sont indispensables à des milliers de patients, dont ceux commercialisés par SANOFI. LUXFER[8], c’est la nationalisation que le gouvernement ne veut pas (13) alors que ses salariés sont en grève depuis 22 mois, avec occupation (avant confinement), pour éviter le déménagement du matériel de production. Face au refus gouvernemental, les salariés montent leur propre projet de reprise en Scop. On ne peut laisser seuls les salariés sur cette affaire. Les citoyens doivent s’en mêler.
Pas de nationalisation sans démocratie sociale
Bien sûr les conditions concrètes de ces nationalisations restent à définir, pour ne pas reproduire les expériences précaires de 1981 et 2008, dont le défaut essentiel est l’absence de démocratie sociale, c’est-à-dire l’absence de participation directe des salariés et des citoyens, dans la décision et la gestion de ce qui est « mis en commun ». La négation de l’agir commun est le principal verrou à faire sauter du capitalisme comme système de domination de l’argent sur l’agir 5. C’est la notion même de marché qui est affectée : il s’agit de transformer le marché des biens et des services pour l’émanciper de la domination financière, en associant souverainement les producteurs, les consommateurs, les usagers-patients, les collectivités territoriales. Il s’agit aussi de dépasser les contradictions de l’État social, dont la redistribution s’essouffle ou est détournée par les politiques d’austérité budgétaire. La démocratie sociale se construit aussi à partir des territoires. Pour associer véritablement les principaux intéressés, patients, professionnels de santé, élus, au plus près des besoins de la population, le processus de décisions doit se structurer du bas vers le haut et non l’inverse.
Une telle ambition est impossible sans le retour au principe fondateur de la Sécurité sociale : remboursement à 100% des médicaments et des soins, démocratisation de sa gouvernance pour rendre aux assurés ce qui leur appartient. Sécurité sociale qui a perdu son indépendance vis-à-vis de l’exécutif gouvernemental (13) et est en grand danger financièrement du fait des exonérations de cotisations patronales ! L’étatisation de la Sécurité sociale et les politiques de rigueur budgétaire ont favorisé une hyper centralisation, dont le danger de bureaucratisation s’est clairement dévoilé dans cette crise. Ceci est un grand sujet en soi dans sa dimension mondiale. Le 21ième siècle est inauguré par la résurgence des épidémies, dont les causes environnementales sont affirmées. Le devenir humain ne pouvant être que collectif, ce siècle devrait s’illustrer par des avancées révolutionnaires en matière de protection sociale[9]. Pourquoi ne pas réfléchir à un concept de Sécurité sociale mondialisée à vocation universelle ? La protection sociale ne peut pas être réservée aux seuls pays développés. L’humanité ne pourra pas faire reculer les risques majeurs de mortalité, en laissant des continents entiers dépourvus de prévention et de soins pour tous. Bien sûr, c’est un combat contre l’obscurantisme quand on voit le désastre de la gestion de l’épidémie au Brésil.
Et les brevets ?
Pour les médicaments et les brevets, dans quelle mesure le principe du commun peut-il devenir un axe du droit à l’échelle mondiale, qui s’impose aux États et aux institutions internationales ? Nous vivons une époque de paralysie de l’ONU, d’attaques contre l’OMS, de toute puissance du FMI et de l’OMC. La logique des marchés s’est imposée sur celle des droits fondamentaux. Pourtant des combats ont été gagnés, notamment contre la pandémie du Sida. De nombreux mouvements altermondialistes interviennent, dont récemment le Réseau européen contre la Privatisation et la Commercialisation de la Santé et de la Protection Sociale ou le People’s Health Movement. L’action altermondialiste est en difficulté, si elle se limite à faire valoir les droits fondamentaux d’accès aux biens considérés comme vitaux, sans envisager la transformation du système politique à l’échelle mondiale, pour faire sauter les verrous qui bloquent cette égalité d’accès. Le Manifeste (9) propose de refonder la législation internationale en matière de propriété intellectuelle et industrielle appliquée aux médicaments, sur la base de la primauté de la santé publique.
La situation dramatique que vivent les peuples face à la pandémie, oblige à être à la hauteur des enjeux. Cet objectif essentiel du « médicament bien commun », pour extraire la santé de la logique d’appropriation des multinationales, a été trop longtemps sous-estimé.
[1] ONDAM : Objectif national des dépenses d’assurance maladie
[2] Chargé de recherche au CNRS, rattaché au Centre de recherche médecine, sciences, santé, santé mentale, société (CERMES3), le sociologue Pierre-André Juven fait ce constat très sévère : « Ce document est le révélateur très net des orientations actuelles en matière de réformes de la santé: nécessité de faire plus de place au privé; croyance forte dans l’innovation numérique comme solution au double enjeu de la qualité des soins et de la contrainte financière; responsabilisation et individualisation face au risque. Les quatre points généraux du document ne sont qu’un coup de tampon aux stratégies édictées depuis plusieurs années. Loin de remettre en cause les orientations délétères des réformes conduites depuis plus de vingt ans, ils conduisent à accélérer la casse de l’hôpital public. Ce document n’est pas seulement la marque d’une volonté d’étendre l’emprise du privé au sein de l’hôpital public, il traduit la conception technophile, néolibérale et paternaliste qu’une grande partie des acteurs administratifs et des responsables politiques ont de la santé. »
[3] JM Harribey, Entretien pour L’Humanité du 24 avril 2020
[4] « Alain Minc : pour une dette publique à perpétuité ! », Les Échos, 16 avril 2020.
[5] Administrateur CGT, Humanité du 29 Avril 2020 « Record de dividendes chez Sanofi »
[6] Pierre Dardot, Christian Laval : Commun, essai sur la révolution au XXIe siècle, La découverte, 2015
[7] Recherche médicaments désespérément, Le Monde du 04/05/2020
[8] LUXFER, seule usine à fabriquer des bouteilles d’oxygène en aluminium, des produits à haute valeur ajoutée capables de supporter des gaz à très haute pression ; bouteilles indispensables aux pompiers, secours d’urgence, hospitalisations à domicile. Le gouvernement est prêt à des « nationalisations temporaires » mais en parlant des grands groupes de l’aéronautique et de l’automobile, en aucun cas pour Luxfer, pour sauver ces groupes comme cela a été le cas pour les banques en 2008. Alors qu’une expertise a démontré que l’entreprise française dégage des marges supérieures aux sites américain et britannique du groupe.
[9] Site OIT /BIT (Bureau international du travail)
Seulement 27 pour cent de la population mondiale bénéficie d’une couverture sociale correcte et plus de 50 pour cent n’en a aucune. L’OIT s’est donné pour mission d’aider les pays à garantir la couverture de tous les groupes sociaux. La sécurité sociale comprend l’accès aux soins médicaux et la garantie de revenu, en particulier pour les personnes âgées et en cas de chômage, de maladie, d’invalidité, d’accident du travail, de maternité ou de disparition du soutien de famille.
Lancée en 2003, la Campagne mondiale sur la sécurité sociale et la couverture pour tous poursuit les efforts déjà entrepris dans plus de trente pays. Elle a notamment permis de mener des projets visant à aider les pays à étendre leur couverture au niveau national et à consolider les régimes de sécurité sociale de type communautaire.
(*) Ingénieure en retraite, membre du collectif d’animation du Manifeste pour une appropriation sociale du médicament