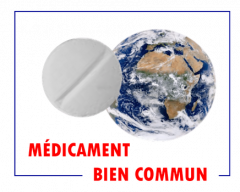Frédérick Stambach, médecin généraliste
Intervention lors de la rencontre-débat du 21 octobre 2023, organisée par Médicament Bien Commun
Introduction
L’article que nous avons écrit avec mon ami et confrère Julien Vernaudon, médecin gériatre, s’intitulait « Pour un pôle socialisé du médicament » (paru initialement dans la revue Pratiques repris ensuite par le site Le Vent Se Lève[1]). Il s’inscrivait dans un contexte particulier puisque nous étions en pleine pandémie de COVID-19, qui avait montré l’état dramatique de notre industrie sanitaire.
D’ailleurs, même le président Macron avait été obligé de l’admettre devant plus 30 millions de français lors d’une allocution. Nous savons, trois ans après, ce que beaucoup d’entre nous savaient déjà en 2020 : il ne s’agissait que d’un discours complètement creux, du Macron pur sucre.
Les différentes interventions, ce matin, ont permis de mettre en évidence, à plusieurs niveaux, la financiarisation des grands groupes pharmaceutiques, notamment de Sanofi, comme le reste de l’économie occidentale en général et française en particulier. Il s’agit d’une tendance structurelle de fond du capitalisme néolibéral débutée, à partir des années 70, qui s’est accélérée depuis l’élection de Nicolas Sarkozy, pour s’épanouir pleinement sous la présidence Hollande puis Macron.
Nous oublions souvent que la France a été un grand pays industriel ayant employé jusqu’à 30% de la population active, contre 15% actuellement. L’industrie pharmaceutique a suivi la même pente, en France comme en Europe, puisque dans les années 90, 80% des principes actifs étaient produits en Europe, contre 20% actuellement, nous rendant dépendant de pays tiers, en particulier la Chine et l’Inde, ce qui n’est pas sans créer de grandes inquiétudes stratégiques, dans un contexte où les tensions internationales montent (en particulier le conflit sino-américain) et où les populations européennes vieillissent, entraînant de plus en plus de pathologies chroniques nécessitant des traitements réguliers. En cas de conflit commercial ou militaire, la dépendance pharmaceutique des pays occidentaux (et de la France dans le cas qui nous occupe) à l’égard du reste du monde nous place dans une position de grande vulnérabilité.
Si nous nous trouvons dans cette situation en 2023, c’est parce que des décisions politiques extrêmement néfastes pour notre tissu productif ont été prises avec constance depuis 1983 et entérinés dans les traités européens. En revanche, ces décisions étaient parfaitement adaptées à l’objectif réel qui était poursuivi : la financiarisation de notre économie.
Pour que la finance, qui n’avait qu’un rôle négligeable dans le capitalisme d’après-guerre, puisse devenir dominante et imposer ses desiderata à toute la société, il est nécessaire d’évoluer dans un régime de libre-échange intégral, en particulier une libre circulation des capitaux. Cette liberté donne aux acteurs de marché, donc in fine aux actionnaires un pouvoir démesuré, tant sur le politique que sur les travailleurs. Cela permet de rentrer dans l’ère de la théorie de la valeur actionnariale qui a été évoquée ce matin plusieurs fois, ce qui signifie que toute la stratégie de l’entreprise est mise au service de l’augmentation de la valeur des actions, sans aucune autre considération, en particulier aucune considération de santé publique ou d’intérêt général pour le pays.
Il est nécessaire également d’avoir une monnaie forte et surévaluée (on considère que l’euro est actuellement surévalué [en 2023 –ndlr] d’environ 30 % par rapport à la productivité de l’industrie française). Cette surévaluation permet de justifier ensuite les délocalisations ou les fermetures d’unités de production en France. Toute dévaluation étant rendue impossible par la monnaie unique, dont la banque centrale est indépendante.
Il faut enfin « discipliner » les gouvernements par la dette, en obligeant les États à s’endetter auprès des marchés financiers[2]. Les États sont alors dans l’obligation de respecter les demandes de leurs créanciers, aiguillés par les fameuses agences de notation. C’est un point capital dans la compréhension de la situation actuelle car les demandes des acteurs de marchés ne sont pas compatibles avec la démocratie et les aspirations populaires en général. Par exemple, attaquer la protection sociale est une bonne chose du point de vue des acteurs financiers car cela ouvre des perspectives de profits (assurances privées, retraite par capitalisation, etc.) et donc cela rend les titres de la dette française attractifs, avec un taux d’intérêt bas. En revanche, augmenter la protection des travailleurs en améliorant le système de santé public ou en renforçant les retraites par répartition est très mal vu et entraînera une réaction inverse et des difficultés, pour le trésor public, à emprunter sur les marchés.
Cette architecture économique met les États européens, donc la France, dans un état de soumission complète vis à vis des marchés financiers. Ces structures sont agencées pour favoriser les intérêts des grands groupes trans-nationaux qui se portent d’ailleurs à merveille, avec des profits record en 2022. Ce n’est pas un effet collatéral mais bien le but qui était recherché par les différents gouvernements, ces contraintes structurelles sont dorénavant sanctuarisées dans les traités européens.
Il est donc important d’avoir cela en tête avant d’aborder la suite car il faut bien comprendre qu’un gouvernement qui aurait le projet de créer un pôle socialisé du médicament, tel que nous l’entendons, se heurterait très durement à ces contraintes. En effet, les acteurs financiers l’analyseraient, à juste titre d’ailleurs, comme un acte d’hostilité et utiliseraient tous les moyens à leur disposition pour s’y opposer (chantage à la dette notamment).
Il faudra donc, en parallèle, avoir un plan global pour se protéger des attaques financières, qui seront très violentes, avec toute une panoplie de mesures graduelles : protectionnisme, sortie ou suspension des traités et de la monnaie unique, réactivation des circuits du trésor, afin de libérer l’État de sa tutelle des marchés financiers…
Un projet de pôle socialisé du médicament implique un très haut degré de conflit politique, dont il faut avoir conscience. Il s’agit d’un projet politique global, qui demandera une implication d’une majorité de la population, préparée aux enjeux et aux difficultés. Car les acteurs du capitalisme financiarisé ne laisseront pas un projet menaçant directement les profits et surtout la puissance politique des grands groupes pharmaceutiques (parmi les plus rentables du monde) se développer tranquillement sans se défendre. Ils feront tout pour le faire capoter.
Sortir les produits de santé du marché : le pôle socialisé du médicament
Notre proposition de pôle socialisé du médicament ne se veut pas en opposition avec la proposition de pôle public du médicament. Nous souhaitions plutôt pousser le concept d’appropriation sociale de la production de médicaments en soulignant les différences qui existent avec le projet de loi proposant la création d’un pôle public du médicament déposé par le groupe LFI lors de la crise COVID[3].
Dans les deux cas, le principe de base reste le même, il s’agit de sortir la production des produits de santé des logiques de marché, à l’aide d’une entité publique de production. Mais autour de ce principe, nous allons voir qu’il existe quelques différences qu’il nous a paru très fécond de mettre en évidence, car nous espérions ainsi provoquer un débat autour de ces questions. C’est souvent entre les partisans d’alternatives que se nouent les débats les plus intéressants, à l’instar des économistes : écouter un débat entre un orthodoxe et un hétérodoxe est souvent frustrant, en revanche un débat entre deux hétérodoxes est passionnant.
Les différences d’approche permettent de clarifier les positions et d’affiner les propositions alternatives, permettant de mettre en lumière des lignes de force politiques sous-jacentes et rarement explicitées.
Tout d’abord, les objectifs d’une telle entité publique devraient être la recherche fondamentale et clinique, la production de produits de santé et leur distribution à l’échelle locale, jusque dans les officines. En particulier, il faudra que tous les médicaments dont les brevets sont tombés dans le giron public puissent être produits.
Ces objectifs sont partagés par les deux concepts, en revanche il existe des modalités différentes concernant la gouvernance.
Dans le projet de loi du pôle public du médicament, il s’agit d’une administration publique « classique », avec un directeur qui est nommé par le pouvoir en place, avec une structure très verticale, assez typique des institutions publiques françaises. Dans notre proposition de pôle socialisé du médicament, nous souhaitons nous inspirer des institutions de la sécurité sociale lors de sa création et jusqu’en 1967. C’est à dire, une gouvernance plus horizontale, incluant toutes les parties prenantes : professionnels de santé, chercheurs, usagers, État. Il faudrait ensuite décliner cette configuration de l’échelle nationale jusqu’à l’échelle locale, c’est à dire départementale, exactement comme la Caisse nationale d’assurance maladie, qui est représentée par les CPAM dans chaque département.
Les représentants de chaque groupe devront être élus par leurs pairs, instaurant ainsi un début de démocratie sociale dans la gouvernance. Cette architecture est une protection contre les attaques potentielles, comme nous avons pu le voir avec la vente de la plupart des entreprises publiques françaises. Un tel pôle socialisé serait beaucoup plus difficile à dépecer, notamment si les citoyens ont réussi à s’en emparer.
Le financement d’un pôle socialisé du médicament devrait se faire, selon nous, grâce au principe de la cotisation/subvention. Nous nous inspirons là encore de ce qui a fonctionné pour la construction de tous les CHU de France dans les années 60–70. D’après la proposition de loi évoquée, le pôle public du médicament serait financé par l’État et l’impôt. Ceci fait une différence politique très profonde, qu’il est important de bien comprendre. Si l’État doit financer le pôle public, cela signifie que, dans l’architecture actuelle du circuit monétaire, à un moment ou à un autre, il faudra en passer par des titres de dette publique contractés sur les marchés financiers, ce qui serait interprété par les agents de ces marchés comme un motif d’augmentation des taux d’intérêt et aboutirait in fine à une perte de souveraineté sur le pôle public du médicament.
En passant par la cotisation/subvention, comme cela a été fait dans le passé, nous court-circuitons le circuit bancaire actuel, parfaitement toxique, ce qui permet une reprise de notre souveraineté économique, actuellement confisquée.
Pour rester sur le versant économique, un gouvernement qui souhaiterait élaborer un tel projet se retrouverait devant des choix économiques assez radicaux. Dans l’histoire, il n’existe pas de pays qui aurait réussi à créer ou recréer une industrie publique, quelle qu’elle soit, dans un contexte de libre-échange intégral. D’autant que, dans notre cas, c’est précisément la liberté totale de mouvements des capitaux et des marchandises (sanctuarisée dans les traités de l’UE comme je l’ai dit en introduction) qui a détruit nos capacités de production. Il faudra donc protéger le pôle socialisé du médicament naissant (ou le pôle public) afin qu’il puisse se développer à l’abri de la concurrence et des attaques des grands groupes pharmaceutiques, qui se sentiront menacés, à très juste titre puisque l’un des objectifs est de créer un véritable rapport de force avec eux pour leur faire perdre une partie de leur pouvoir de nuisance. Avoir une capacité de production publique autonome permettrait, par exemple, d’activer la menace de la licence d’office comme cela a été expliqué dans les interventions de ce matin. En régime capitaliste, pour qu’un État puisse se faire respecter des grands groupes, il faut qu’il ait des capacités de production autonomes.
Ainsi, la création d’un pôle socialisé du médicament provoquerait un renchérissement du prix des médicaments génériques, actuellement produits au plus bas coût social et écologique. Cependant, comme l’a souligné Maurice Cassier dans les différents exemples qu’il a donnés[4], il ne faut pas s’arrêter au seul prix des médicaments mais regarder toute la chaîne de valeur. La création d’usines de production provoquerait de l’emploi bien rémunéré, donc une augmentation du nombre de cotisants ainsi qu’une baisse du chômage. Tout cela entraînant une augmentation de richesses qui contrebalancerait la hausse du prix des génériques pour la collectivité.
De plus, le phénomène inverse s’observerait concernant les molécules les plus récentes donc les plus onéreuses. Actuellement, le circuit financier qui permet l’apparition de nouveaux (onéreux) traitements est marqué par une classique privatisation des profits. Les nouveautés sont souvent issues de la recherche publique, rachetées ensuite par des start-ups qui sont ensuite introduites en bourse puis accaparées par les grands groupes pharmaceutiques. Ces derniers commercialisent ensuite les traitements au prix fort selon un processus de négociation opaque, qui n’a rien à voir avec le coût de production mais plutôt avec le rapport de force (très défavorable) qui existe entre les États et les grands laboratoires pharmaceutiques[5]. En ce qui concerne les pays occidentaux, ce sont les systèmes de santé publics qui assurent l’achat de ces traitements, ce qui signifie que les grands groupes profitent de l’argent public à deux moments clés : au moment de la recherche fondamentale, puis lorsqu’il faut payer les traitements, en empochant au passage des bénéfices colossaux.
C’est de cette véritable spoliation que permet de sortir un pôle socialisé du médicament, en permettant à la recherche publique d’avoir un débouché industriel non lucratif et en modifiant le rapport de force lors des négociations avec les grands groupes qui détiennent les brevets de molécules innovantes. La menace de la licence d’office deviendrait une réalité concevable tirant à la baisse les prix des nouveaux traitements[6].
Pour terminer, j’ajoute que cette proposition de pôle socialisé du médicament s’intègre pour nous dans un projet plus global de service public de santé territorial. Il s’agit d’une série de trois articles publiés sur le site ReSPUBLICA dont le pôle socialisé serait l’une des composantes[7].
A partir de l’analyse détaillée de l’évolution démographique des différentes professions de santé (médecins, sage-femmes, dentistes, infirmiers, kiné), nous concluons que la pénurie (en particulier médicale) est irréversible jusqu’en 2035. Nous devons donc libérer du temps de soins au « stock » de soignants dont nous disposons et permettre aux professionnels qui le souhaitent de se libérer du paiement à l’acte et de pouvoir être salariés, afin de limiter au maximum la perte de temps liée au travail administratif. Il est actuellement estimé entre 15 et 20 %, ce qui est énorme. Il s’agirait, encore une fois en se basant sur l’architecture de la Sécurité sociale version 46, de lancer la construction de centres de santé partout sur le territoire (pilotée par l’équivalent des caisses départementales de Sécurité sociale dans une version démocratisée), pour permettre aux professionnels libéraux de trouver facilement un poste salarié et de gagner ainsi en temps de soins.
Dans notre proposition, nous souhaitons intégrer les pharmaciens et tout le personnel des officines à ces centres de santé. Ces officines publiques pourraient s’approvisionner via le pôle socialisé du médicament. Nous souhaitons également permettre aux métiers du lien, tels que définis par la proposition de loi présentée par François Ruffin[8], d’intégrer les centres de santé leur conférant ainsi un statut digne de leur utilité sociale.
Conclusion
Comme nous l’avons vu, un pôle socialisé du médicament est un projet global, hautement politique, qui fait intervenir tous les aspects de notre vie publique : la démocratie, la macro-économie, la géopolitique et la santé publique, dans un domaine industriel stratégique, qui plus est pour des sociétés occidentales vieillissantes. Il demanderait une volonté et une vision politique qui seraient capable de redonner espoir à des citoyens plutôt habitués à se battre pour tenter de limiter la casse de leurs droits sociaux, sans grand succès d’ailleurs.
Il est également souhaitable de l’intégrer dans un projet politique plus global de notre système de santé, en voie d’effondrement si les logiques en cours se maintiennent.
Enfin nous estimons qu’un tel projet serait de nature à mobiliser des affects positifs beaucoup plus puissants que ceux mobilisables pour tenter de défendre ce qui existe, nous permettant de repasser à l’offensive. Il oblige à clarifier un certain nombre de positions, à prendre conscience des grands enjeux macro-économiques actuellement confisqués par l’UE et à remettre sur le devant de la scène nos expériences historiques de démocratie sociale. Nous pensons qu’il devrait être le cœur d’un programme de gauche pour avancer vers la République sociale que nous appelons de nos vœux.
[1]https://pratiques.fr/Pour-un-pole-socialise-du-medicament et https://lvsl.fr/pour-un-pole-socialise-du-medicament/
[2]Benjamin Lemoine, La démocratie disciplinée par la dette. La découverte, 2022
[3]https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/dossiers/pole_public_medicament
[4]Maurice Cassier, Il y a des alternatives. Une autre histoire des médicaments (XIXe-XXIe siècle), Seuil, 2023
[5]Olivier Maguet, La santé hors de prix : L’affaire Solvaldi, Raisons d’Agir 2020
[6]Frédéric Pierru, Frédérick Stambach et Julien Vernaudon, Les brevets, obstacles aux vaccins pour tous, Le Monde diplomatique, Mars 2021
[7]Frédérick Stambach et Julien Vernaudon, Pour un service public de santé territorial en trois volets, journal en ligne ReSPUBLICA, Mai-juin 2022
[8]https://francoisruffin.fr/pour-la-reconnaissance-des-metiers-du-lien/