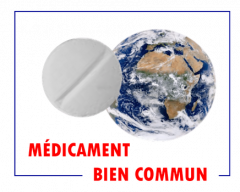La pandémie mondiale accélère la prise de conscience que la santé est un droit humain fondamental et un commun mondial. Mais face aux pouvoirs monopolistiques de l’Industrie Pharmaceutique (IP), cette conscience est plus hésitante à intégrer le médicament comme bien commun. Or, quelle est l’alternative à l’emprise de la domination de l’IP sur la recherche, la production et la distribution des médicaments, sans sortir le médicament de la marchandisation, sans maîtrise par la société de sa politique de santé ?
Depuis quelques mois, des mobilisations citoyennes s’expriment sur la nécessité d’une maîtrise de la politique du médicament, pour assurer la transparence des prix, l’absence de pénurie, l’indépendance thérapeutique et sanitaire, la démocratie sanitaire. Revendiquer le médicament comme bien commun, n’est pas céder au credo dans lequel s’est engouffré le libéralisme, pour entretenir la confusion, en déclarant les vaccins « Bien Public Mondial ». Pour les libéraux, cela veut dire : les États, donc les deniers publics, financent lourdement les IP pour la recherche, la production et la prise en charge de la pharmacovigilance des vaccins. Et les IP fixent les conditions de mise à disposition, assurent leur monopole mondial par les brevets (avec la complicité des États des pays riches à l’OMC) et engrangent les profits. Christian Laval, lors d’un récent entretien avec le collectif Médicament bien commun (MBC), a clarifié ces deux notions, diamétralement opposées, sans ambiguïté[1].
Sortir le médicament de la marchandisation
Transformer profondément la situation dans le sens de l’égalité du droit à la santé s’accorde mal avec le maintien du médicament comme marchandise sous domination du marché.
Pour progresser vers « la santé, commun mondial », quatre conditions sont au moins nécessaires :
- Chaque pays a besoin d’un grand service public de la santé, qui ne se limite pas à l’hôpital, mais intègre et développe toutes les structures territoriales compétentes, de proximité, pour prendre en charge les patients à égalité de droits et d’accès. Une politique publique de santé, à l’opposé d’une individualisation des risques, développant la prévention dans tous les domaines du bien-être physique et psychique de leurs habitants (intégrant donc tous les facteurs sociaux et environnementaux). La santé publique ne doit pas être influencée par le secteur privé. Il est notamment nécessaire de revenir sur la sur-médicalisation ou le façonnage de la maladie, dont les laboratoires ont été porteurs à travers, entre autres, la modification de normes scientifiques visant à justifier une prescription. Exemples : abaisser le seuil de risque du taux de cholestérol, ou passer à l’obligation vaccinale pour 11 vaccins, dès les premiers mois de vie contre 3 auparavant. Besoin sanitaire réel ou réponse aux laboratoires qui ne voulaient plus produire le simple DTPolio ?
Nous sommes très loin du compte, même dans les pays dit riches, dont le nôtre, maltraités par des décennies de politiques malthusiennes libérales, le plus souvent sans protection sociale.
- Nous devons renforcer les connaissances pharmacologiques des professionnels de la santé, pour les rendre autonomes dans les appréciations des bénéfices thérapeutiques de nouvelles molécules, sur la base de rapports de recherche scientifique[2].
- La recherche fondamentale publique, pour être créative, doit être indépendante dans ses choix, donc non dépendante des fonds privés pour la financer, ce qui implique un budget pour la recherche publique et universitaire, à la hauteur des besoins, un changement radical de la situation actuelle : en France, ce budget est le plus faible d’Europe, à peine 2% du PIB.
- Un pôle public de recherche et de production de médicaments, qui échappe à la domination des Big Pharma et à la tutelle de l’État, dont la haute fonction publique est aujourd’hui imprégnée de l’idéologie néolibérale[3], permettra d’amorcer le processus d’appropriation sociale. Il s’agit de financer une recherche biomédicale publique, en travaillant en étroite collaboration avec les équipes de recherche fondamentale, être force de proposition et d’innovation en fonction des besoins de la population et d’intégrer les essais cliniques dans ces organismes publics de recherche biomédicale, pour une évaluation des thérapies innovantes, indépendante des fonds privés.
Nous avons donc besoin d’une « appropriation sociale » de toute la chaîne de la santé et du médicament, adaptée aux besoins et aux valeurs de la société, hors du champ de la propriété privée, pour ce qui est des biens jugés essentiels pour la santé, et dont les citoyen.ne.s ont la maîtrise. Une telle transformation ne peut se concevoir et se construire qu’à partir de la réalité de la filière pharmaceutique. Les tensions de la situation actuelle montrent que son avenir se joue maintenant.
L’avenir de la filière scientifique et industrielle pharmaceutique se joue maintenant !
En France, la filière scientifique et industrielle pharmaceutique, de statut privé, est au bord de la catastrophe. Le nombre de sites industriels est passé de plus de 400 à 250 en 20 ans et les effectifs en Recherche et Développement, qui constituent le moteur de l’activité, de 24000 à 13000. L’exemple de Sanofi est à ce titre démonstratif. Nous sommes confrontés à la stratégie financière du principal groupe pharmaceutique mondial sur notre territoire : fermeture de centres de recherche, arrêt d’axes thérapeutiques jugés insuffisamment rentables, galaxie de start-up créées au fur et à mesure des externalisations, ce qui conduit à la disparition de la filière industrielle et scientifique de la pharmacie et à une défaillance de réponse à de nombreux besoins de santé fondamentaux. On peut citer, entre autres, l’arrêt des recherches sur la maladie d’Alzheimer et de Parkinson, le désengagement de la recherche de nouveaux antibiotiques alors que la pandémie actuelle nous montre l’absolue nécessité de trouver de nouveaux traitements. Seul l’axe thérapeutique de l’immuno-oncologie reste réellement travaillé en France car, dixit le Directeur général, nous ne pouvons pas être absents du « marché » de l’immuno-oncologie en croissance constante.
En 12 ans, le nombre de sites de R&D de Sanofi en France est passé de 11 à 3 si le plan de restructuration actuel est mis en œuvre, et le nombre de salariés en R&D, de 6350 à moins de 3000, malgré les nombreuses aides publiques versées, sans aucune contrepartie. Les pertes d’expertise sont colossales. L’échec actuel de Sanofi dans le développement d’un vaccin contre la Covid ne vient que confirmer ce constat. Bien évidemment les sites de production de Sanofi (tant de production de principes actifs que de formulations pharmaceutiques) sont également menacés, soit d’externalisation, soit de fermeture, l’entreprise entendant se désengager de 200 familles de médicaments sur 300, sur la base du seul niveau du chiffre d’affaires (CA). L’externalisation est une des principales causes des ruptures de l’approvisionnement, multipliées par 20 depuis 2008.
Le risque du démantèlement du groupe Sanofi est majeur comme cela s’est passé pour d’autres fleurons industriels français (Alcatel/Alstom, Péchiney …). Les autres laboratoires pharmaceutiques français, beaucoup plus petits (Servier, Fabre, Ipsen …), sont également en position difficile.
Un pôle public du médicament, pour quelles missions ?
Le groupe des sénateurs Communistes et le groupe des députés Insoumis ont déposé chacun une proposition de loi portant création d’un pôle public du médicament [4]. Plusieurs définitions sont avancées : « Établissement public », de recherche et de production de médicaments, « Établissement public d’État (ou agence publique) »,coordonnant l’ensemble des établissements d’État du périmètre des missions…Par ailleurs, des mobilisations citoyennes exigent la réquisition des labos privés pour la production des vaccins. Ces perspectives méritent un vrai débat public, d’autant qu’en France, nous avons un historique riche d’enseignements concernant les nationalisations et les grands services publics, et que nous pouvons faire aujourd’hui le bilan de trois décennies de privatisations et déréglementations.
Le collectif MBC s’inscrit légitimement dans cette réflexion. Il a été à l’initiative du Manifeste pour une appropriation sociale du médicament en Janvier 2018[5]. Ce qui suit est basé sur les questionnements et les hypothèses que le collectif soumet notamment aux auteurs des projets de loi.
Avant de nous interroger sur le statut juridique de ce pôle public, nous devons questionner les besoins et les missions attendues. L’ampleur des besoins de santé, l’importance des reculs et des tensions révélés par la crise pandémique, invitent à penser que la création d’un tel pôle public ne peut se réduire à la seule intégration de la Pharmacie des Hôpitaux et de la Pharmacie de l’Armée, ni se limiter à la réquisition des labos privés pour la production des seuls médicaments en rupture, via la licence d’office entre autres. La question de l’intégration des capacités de recherche et industrielles de Sanofi, même affaiblies, est posée. Près de 50 % des activités pharmaceutiques françaises sont regroupées en son sein.
Quelles sont les attentes exprimées dans les diverses mobilisations, depuis des années, qui se font plus urgentes aujourd’hui ?
- Répondre aux besoins réels de la population en matière de santé (prévention et soins), en veillant à un meilleur usage des médicaments ; ce qui passe par une réelle écoute de toutes les parties prenantes (médecins, épidémiologistes, pharmacologues, personnels de la santé publique, patients…) en vue de mettre au point les traitements.
- Partager les connaissances et les technologies dans le domaine médical, au niveau mondial, de manière permanente (ce qui se fait déjà). Ce partage (par revues scientifiques, symposiums ou conférences médicales, information et formation continue des professionnels de santé) doit pouvoir se faire de manière indépendante des lobbys privés et hors de toute guerre commerciale.
- Revoir les conditions d’autorisation de mise sur le marché (AMM), pour limiter les médicaments « me-too », ou de simples changements de formulation, bénéficiant d’un marketing efficace. N’autoriser que des médicaments apportant des améliorations majeures pour les patients.
- Obtenir la transparence des coûts de recherche, de production et de l’utilisation des fonds publics ;
- Réformer le système de fixation des prix des médicaments en lien étroit avec la Sécurité sociale (SS). Le contrôle des prix par un observatoire citoyen est-il suffisant pour faire face ou transformer le système actuel ? Cet observatoire peut être efficace s’il a la garantie d’avoir accès à toutes les informations, si sa composition est réellement représentative et sa recommandation suivie d’effet.
- Créer de nouvelles conditions de propriété intellectuelle, invalidant le pouvoir monopolistique et marchand des brevets.
Ces objectifs seront-ils considérés comme des missions pour cette entité scientifique ? A la lumière de l’expérience du fonctionnement d’organismes tels que l’ANSM et la HAS, pour remplir de telles missions, elle doit non seulement rassembler les compétences nécessaires (nous n’en manquons pas dans la communauté scientifique), mais elle doit avoir un statut réellement indépendant des entreprises pharmaceutiques, et également de l’État (administration, exécutif). Cette entité doit être redevable de ses missions, ses objectifs et de son bilan financier, envers les deux assemblées parlementaires et devant le conseil d’administration, nouvellement élu, de la Sécurité Sociale, selon la loi instituant la création du pôle public.
Compte tenu de l’affaiblissement, notamment en France, du potentiel de recherche dans le domaine médical, la nature du lien entre la recherche publique au sein des grands organismes (INSERM, CNRS, CEA) et la recherche appliquée de caractère industriel, est à refonder. Ce pôle doit avoir les moyens financiers et humains (en effectifs et compétences) de mener une mission de recherche appliquée dans la découverte et le développement de molécules et de médicaments (notamment les médicaments d’intérêt thérapeutique majeur- ITM), y compris d’innovations de tout premier ordre. Ceci implique le renforcement du financement public et les garanties de l’indépendance de ce financement, pour le plein exercice des choix de recherche en lien avec les besoins de santé.
Il faut adjoindre au pôle de recherche, un outil de production. Il est indispensable d’intégrer les sites et les expertises existants de Sanofi et d’autres laboratoires ; dans un premier temps, intégrer les sites menacés de fermeture ou de vente de la R&D et de la production (pour arrêter l’hémorragie), comme première étape de l’appropriation sociale de toute la filière industrielle et de recherche.
Ce pôle ne peut pas être un palliatif des carences ou des abandons des labos privés, en laissant dépérir la filière pharmaceutique.
Quel statut juridique ? Quels financements ? Quels liens avec la Sécurité sociale ?
Il est nécessaire de clarifier ces questions, compte tenu des expériences antérieures des nationalisations ou de la mixité public-privé, notamment en France. L’évolution d’EDF vers la privatisation, depuis son changement de statut d’EPIC en SA en 2004, même avec un État actionnaire à 84%, introduit en bourse en 2005, est un exemple significatif de la confiscation à la fois étatique et privée, d’un Bien Commun qu’est l’Énergie.
Il n’existe que deux statuts juridiques pour une entreprise à caractère industriel : l’EPIC (Établissement public industriel et commercial) ou la Société anonyme (SA). La maitrise publique de ce pôle se traduira-t-elle par la création d’un EPIC, dont la base financière repose exclusivement sur des capitaux publics et sur un autofinancement ? Dans un établissement de statut public, les orientations stratégiques et de gestion ne sont pas tributaires de la valorisation du patrimoine des actionnaires, à la différence de la Société anonyme. L’EPIC est redevable de ses orientations et de son bilan financier envers la nation et les instances parlementaires, selon la loi qui l’institue.
La contribution financière éventuelle et les rapports avec la Sécurité Sociale sont à définir. Les multiples atteintes prédatrices de l’État et des entreprises (exonérations de cotisations) contre la SS, obligent à penser le financement de ce pôle dans le cadre d’un retour aux principes fondamentaux de notre protection sociale, en coordination avec les caisses de Sécurité Sociale (désétatisées) et les mutuelles réellement engagées dans cette optique[6] . Allocation d’une part des cotisations sociales à ce financement ? La question mérite d’être posée.
Les projets de loi 4 proposent également que la contribution sur le chiffre d’affaires à laquelle sont assujetties les entreprises pharmaceutiques soit portée de 0,18% à 1%, ce qui pourrait engendrer une recette supplémentaire de 262,4 millions d’euros… à comparer au CA 2019 de l’IP, soit 60 milliards€. Une autre proposition est d’avoir recours à des fonds socialisés d’investissement, alloués, non sur des critères de rentabilité, mais en fonction des besoins, définis par les différentes parties prenantes[7].
Quelle gouvernance, pour quels pouvoirs des citoyens et des acteurs de la santé ?
L’implication des citoyens et des acteurs de la santé dans la gouvernance est essentielle. Ne pas les entendre, nier leur avis et leurs compétences, leur coopération, s’avèrent nuisible. La lutte actuelle contre la pandémie est là pour le rappeler cruellement. Tous les acteurs, c’est-à-dire les professionnels de santé, les chercheurs, les patients, les associations de malades, les salariés, les élus, la société civile, les pouvoirs publics.
Comment intégrer cette dimension dans la conception de la direction et la gestion de ce pôle public ? Quelle composition de son conseil d’administration, par quel mode de désignation, élection ou désignation par l’État ? Quelles seront les garanties d’indépendance vis-à-vis de l’administration d’État, notamment pour la définition des objectifs et plans de développement, répondre aux exigences de pharmacovigilance ? La composition du CA suffit-elle à assurer la démocratie des décisions impactant la politique de santé publique ? Nous avons la conviction que cela est très insuffisant pour instituer un « commun ». Comment organiser l’implication citoyenne dans un débat public pour définir la politique de santé publique ? Pour qu’elle ne soit pas laissée aux seuls « experts » ?
L’histoire de la confiscation du pouvoir des citoyens par l’étatisation de la Sécurité sociale, doit servir d’expérience à ne pas reproduire. Cette étatisation a pour conséquence la mise en danger des équilibres financiers et la dépossession des citoyens d’une des plus grandes conquêtes sociales du 20e siècle. L’État n’est pas en soi une garantie de démocratie.
Pour que la maîtrise publique ne se transforme pas en étatisation
L’État français ne s’est pas opposé à Sanofi lors de la délocalisation de certaines productions de principes actifs en Chine et en Inde. Il ne s’est pas opposé aux restructurations, plans successifs de suppression de postes et de sites de recherche, alors qu’il a abondé le CICE et le CIR en centaines de millions d’euros, sans aucune exigence de contrepartie. La réalité est que l’État est sous la domination de l’IP.
L’État, les États (avec la crise sanitaire et environnementale, notre situation est le reflet de la situation mondiale) peuvent-ils fonctionner au service de la société et des populations, être des instruments d’une coopération mondiale pour satisfaire les droits fondamentaux ? Actuellement, l’État, les États, fonctionnent dans un environnement concurrentiel de « guerre économique », y compris sous l’égide d’institutions internationales telles que l’OMC et le FMI. Certains États se sont même opposés aux recommandations de l’OMS. La réglementation est définie et imposée par les stratégies industrielles, véritables dictatures avec leurs règles propres, transnationales, par-dessus les États.
Pour résister à ces pouvoirs dominateurs, développer de manière pérenne l’activité de ce pôle, sa maîtrise doit pouvoir reposer sur un processus permanent d’appropriation sociale, démocratique, donc citoyen, favorisant un agir commun qui donne son véritable sens à « médicament bien commun ». A l’opposé du protectionnisme ambiant, ses missions doivent s’inscrire dans une politique volontariste de coopérations internationales dans le domaine de la santé et de la recherche. Avec un idéal de protection sociale mondialisée. Son activité obligera à faire face aux instances et traités de libre échange (OMC, TAFTA…), en particulier en ce qui concerne les brevets. La démonstration peut être faite que l’innovation peut se passer de la propriété exclusive des brevets, ce qui est de nature à ouvrir bien des portes pour des coopérations et partages de connaissances et technologies. Ces transformations doivent s’opérer au niveau européen, en particulier dans les missions de l’Agence européenne des médicaments (EMA), qui visent à assurer la surveillance continue des médicaments au profit de la santé des citoyen·ne.s de l’Union européenne. Extraire l’EMA de la subordination aux intérêts de l’IP est urgent car les procédures d’Autorisation de Mise sur le Marché sont loin d’être satisfaisantes.
Collectif Médicament Bien Commun
25/04/2021
[1] « …les BPM renvoient à la catégorie de « biens publics » de l’économie mainstream qui établit une distinction entre types de biens en fonction de critères techniques (non-exclusivité, non rivalité). Les « biens communs » tels que nous devons les redéfinir dans une politique du commun renvoient à des exigences éthiques et politiques d’universalité et de solidarité, qui ne sont pas limitées par les catégorisations économiques qui font des biens marchands la règle et les autres des exceptions ! Le déplacement d’accent est radical, c’est même une opposition entre deux conceptions qui n’ont rien à voir l’une avec l’autre. D’un côté, le bien public est strictement défini par le discours économique dominant, et bien sûr derrière, par le fonctionnement du capitalisme qui a besoin que l’État produise des biens publics (éclairage des rues, phares, armée etc. pour reprendre des exemples classiques). »
[2] Actuellement, ce sont les visiteurs médicaux, salariés des IP, qui informent des résultats de recherches et d’études cliniques, rédigés par les entreprises elles-mêmes.
[3] Rappelons que cette doxa libérale a conduit toutes les privatisations durant trois décennies ; ceci est très bien documentée par Laurent Mauduit : « Prédations, histoire des privatisations des biens publics, La Découverte, 2020.
[4] Groupe CRCE au Sénat : Proposition de loi N°667 du 27 juillet 2020
Groupe LFI Assemblée Nationale : Proposition de loi N°3014 Avril 2020
[5] Qui sommes-nous ? Salarié(e)s de l’industrie pharmaceutique, professionnels de la santé, chercheurs, retraité(e)s, journalistes, sociologues, élu(e)s, syndicalistes, militant(e)s politiques ou d’associations…nous avons décidé de contester la marchandisation de la santé et d’arracher les pouvoirs de décision pour répondre aux besoins universels de santé. Pour commencer, travailler sur cet outil de la marchandisation qu’est le brevet du médicament.
[6] La réflexion de Christian Laval lors d’un récent entretien avec le collectif MBC a attiré tout notre intérêt : « La voie qu’il faudrait explorer renouerait avec une vieille tradition trop oubliée du mouvement socialiste : la prise en charge de la recherche appliquée, du développement et de la production des médicaments par les mutuelles et coopératives, par les caisses de sécurité sociale (désétatisées), par le monde associatif, enfin par tous les acteurs non spéculateurs et non capitalistes qui pourraient mobiliser une part importante de l’épargne volontaire et une part des cotisations sociales dans l’innovation et la production. On voit mal pourquoi, par exemple, l’Économie sociale et solidaire ne commencerait pas à prendre toute sa part et ses responsabilités dans ces activités. Quant aux délibérations, expertises, et décisions, elles ne pourraient qu’être issues de la société elle-même dans le cadre d’institutions démocratiques adéquates, dont l’actuel Conseil économique et social et environnemental n’est qu’une très pâle esquisse. »
[7] Au-delà de la propriété. Pour une économie des communs. Benoît Borrits, 2018, Editions La Découverte, collection : L’horizon des possibles